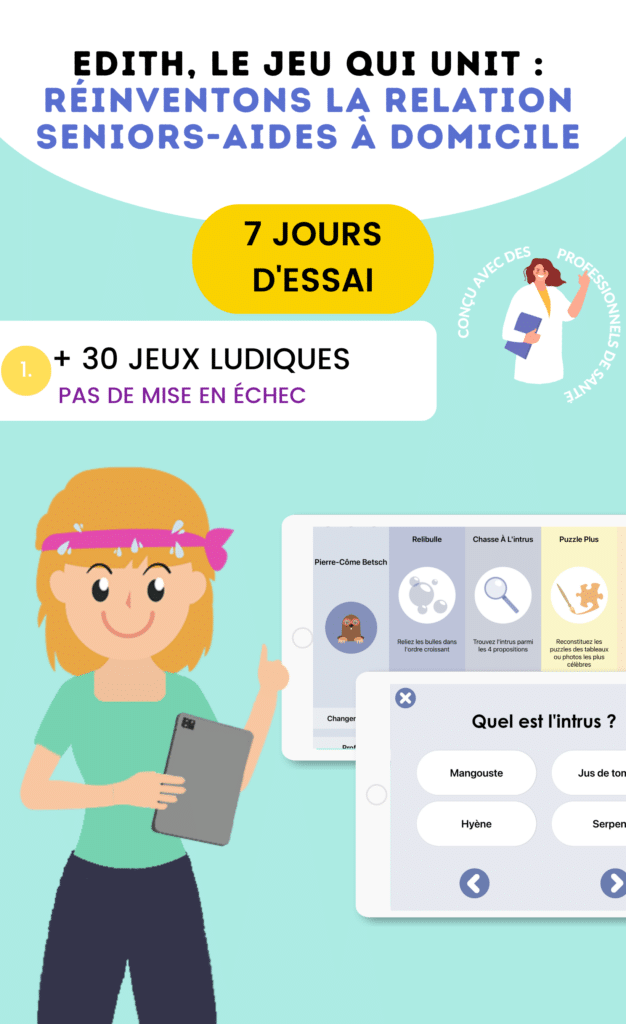Dans notre parcours d’accompagnement des familles et des professionnels, nous sommes confrontés à l’une des situations les plus angoissantes liées à la maladie d’Alzheimer : la fugue, ou plus précisément, l’errance. Ce n’est pas une tentative d’évasion volontaire, mais plutôt la manifestation d’une boussole interne qui s’est déréglée, une quête confuse menée par un esprit qui a perdu ses repères. La peur qui saisit un aidant lorsqu’il réalise que son proche n’est plus là où il devrait être est un sentiment glaçant. C’est pourquoi nous avons développé des protocoles clairs et des outils d’accompagnement, non seulement pour réagir en cas de crise, mais surtout pour la prévenir.
Au cœur de notre démarche, il y a la formation. Lors de nos sessions de formation, comme celle que nous proposons pour apprendre à stimuler et créer du lien, nous insistons sur le fait que comprendre le comportement est la première étape pour le prévenir. Une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ne fugue pas par défi. Elle suit une logique qui lui est propre, dictée par ses souvenirs, ses émotions et ses besoins non exprimés. Notre mission est de vous donner les clés pour décrypter cette logique et construire un environnement sécurisant et bienveillant. Cet article est une extension de cet engagement : un guide pratique pour vous aider à tisser un filet de sécurité autour de votre proche et à savoir comment réagir si, malgré tout, il venait à s’égarer.
Pour agir efficacement, il nous faut d’abord comprendre. L’errance n’est jamais un acte anodin ou aléatoire. Elle est la conséquence d’une confusion interne profonde, d’un besoin ou d’une anxiété. Imaginez-vous un instant dans un monde où les visages familiers semblent étrangers, où les routines d’hier n’ont plus de sens aujourd’hui, et où les mots pour exprimer une simple douleur ou une envie vous échappent. Dans ce brouillard cognitif, la marche devient parfois la seule réponse possible, une tentative de retrouver un semblant de contrôle ou un fragment de son ancienne vie.
Les déclencheurs courants de l’errance
Les raisons qui poussent une personne à errer sont multiples et très personnelles, mais nous pouvons identifier des schémas récurrents. Comprendre ces déclencheurs est le premier pas vers la prévention.
- La recherche d’un passé révolu : Très souvent, la personne ne cherche pas à fuir le présent, mais à rejoindre le passé. Elle peut vouloir “rentrer à la maison” (même si elle y est déjà, elle pense à sa maison d’enfance), aller “chercher les enfants à l’école” (même s’ils sont adultes depuis des décennies) ou se rendre à son ancien lieu de travail. Ces destinations sont ancrées dans sa mémoire à long terme, qui reste souvent préservée plus longtemps que la mémoire récente.
- La réponse à un besoin non satisfait : L’incapacité à communiquer une gêne physique est un puissant moteur de fugue. La faim, la soif, le besoin d’aller aux toilettes, une douleur ou un inconfort (vêtement trop serré, pièce trop chaude) peuvent générer une agitation qui se traduit par le besoin de bouger, de “sortir” pour trouver une solution.
- L’anxiété et le stress : Un environnement trop bruyant, trop agité, la présence de trop de personnes inconnues, ou même un sentiment de solitude ou d’abandon peuvent provoquer une angoisse intense. La fuite devient alors un mécanisme de défense pour échapper à cette situation perçue comme menaçante.
- L’ennui et le manque de stimulation : Une personne laissée sans activité ni interaction peut se mettre à déambuler simplement par manque de stimulation. Le corps a besoin de bouger, l’esprit a besoin d’être occupé. Sans but précis, la marche devient une fin en soi.
Le rôle de l’environnement et de la routine
L’environnement joue un rôle crucial. Un lieu de vie mal adapté, où les repères sont flous, peut augmenter le risque de fugue. Un couloir long et vide peut inviter à la marche, une porte d’entrée bien en vue peut être perçue comme une sortie à emprunter. La perte de la notion du temps est également un facteur aggravant. La tombée de la nuit, par exemple, est un moment de grande angoisse pour beaucoup (le “syndrome crépusculaire”), où la confusion s’accentue et l’envie de partir peut devenir irrépressible.
La routine est l’ancre qui maintient la personne connectée au présent. Un emploi du temps régulier pour les repas, la toilette, les activités et le coucher aide à structurer la journée et à réduire l’anxiété. Toute rupture dans cette routine (un rendez-vous médical, la visite d’un inconnu) peut être un élément perturbateur et un déclencheur potentiel. C’est pourquoi nous insistons tant, dans nos formations, sur l’importance de créer des rituels positifs et rassurants.
La prévention : Mettre en place un filet de sécurité
La meilleure façon de gérer une fugue est de faire en sorte qu’elle n’ait pas lieu. La prévention est un travail de tous les instants, qui mêle adaptation de l’environnement, stimulation cognitive et affective, et communication. Il s’agit de construire un cocon sécurisant, un “chez-soi” qui soit un refuge et non une prison.
Sécuriser le domicile
Sécuriser le domicile ne signifie pas le transformer en forteresse, mais plutôt en un espace où les risques sont minimisés de manière discrète et intelligente. Il faut trouver un équilibre entre la sécurité et la préservation de la dignité et de la liberté de mouvement de la personne.
- Les portes : La porte d’entrée est l’élément le plus critique. Vous pouvez installer des verrous complexes à manipuler ou placés en hauteur/en bas de la porte, hors du champ de vision habituel. Une autre astuce consiste à “camoufler” la porte en la peignant de la même couleur que le mur ou en plaçant un grand rideau devant. Des alarmes de porte discrètes peuvent vous alerter si elle est ouverte.
- Les nouvelles technologies : Des dispositifs de suivi GPS, sous forme de montre, de pendentif ou de semelle à glisser dans la chaussure, peuvent être une solution rassurante. Ils permettent de localiser rapidement la personne si elle venait à s’égarer, réduisant ainsi le temps de recherche et les risques associés.
- L’information : Assurez-vous que votre proche ait toujours sur lui une forme d’identification : un bracelet gravé, une carte dans son portefeuille ou une étiquette cousue dans ses vêtements, avec son nom et un numéro de téléphone à contacter. Précisez “Je suis atteint(e) de troubles de la mémoire, merci de contacter ce numéro”.
Créer un environnement stimulant et apaisant
Un esprit occupé est un esprit moins enclin à l’errance. L’ennui et l’anxiété, nous l’avons vu, sont des déclencheurs majeurs. L’objectif est donc de proposer des activités adaptées qui donnent un but à la journée et renforcent le lien social. C’est précisément la philosophie derrière nos applications.
C’est là que nos outils comme EDITH, nos jeux de mémoire sur tablette, prennent tout leur sens. Nous les avons conçus non pas comme de simples exercices, mais comme des ponts pour la communication. Une partie de quiz musical, un jeu de reconnaissance de proverbes ou une reconstitution de photos de famille ne stimulent pas seulement la mémoire. Ils créent un moment de partage, un dialogue, un sourire. Cet instant de connexion ancre la personne dans le présent de manière positive. En partageant cette activité avec elle, vous lui offrez une attention de qualité qui répond à son besoin de reconnaissance et diminue son anxiété. Moins anxieuse et plus engagée, elle aura moins de raisons de chercher une échappatoire.
L’importance de la communication et de l’identification des besoins
Parfois, la fugue est un cri silencieux, l’expression d’un besoin que la personne ne peut plus formuler avec des mots. La frustration de ne pas être compris est immense et peut mener à des comportements d’agitation. Comment une personne peut-elle dire “j’ai mal au ventre” ou “j’ai soif” quand les mots lui manquent ?
Pour répondre à ce défi, nous avons développé MON DICO. Cet outil simple sur tablette ou smartphone utilise des images et des pictogrammes pour aider les personnes ayant des troubles cognitifs à exprimer leurs besoins fondamentaux : manger, boire, avoir froid, ressentir une douleur, etc. En pointant une image, la personne peut communiquer un besoin essentiel. En désamorçant la frustration à la source, vous prévenez l’agitation qui pourrait conduire à une fugue. C’est un outil simple mais puissant pour maintenir le dialogue ouvert lorsque les mots ne suffisent plus.
Le protocole d’alerte : que faire dans les premières minutes ?
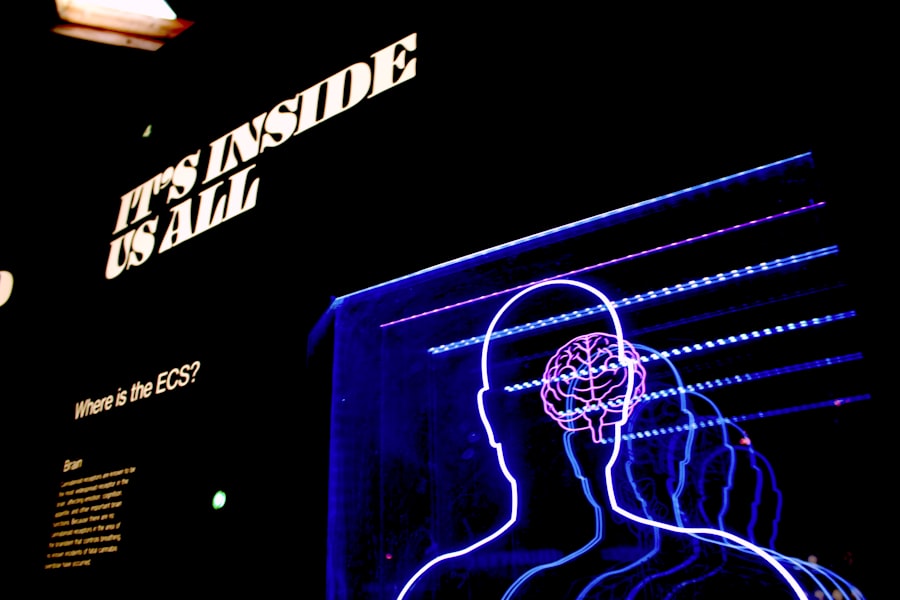
Malgré toutes les précautions, une fugue peut survenir. La rapidité de réaction est alors cruciale. Les premières minutes et la première heure sont déterminantes. Il est essentiel d’avoir un plan d’action clair pour ne pas céder à la panique et agir de manière méthodique.
L’évaluation initiale : ne pas paniquer, mais agir vite
La première chose à faire est de garder son calme, même si c’est la chose la plus difficile au monde. Votre clarté d’esprit est votre meilleur atout.
- Vérification immédiate : Cherchez d’abord dans et autour du lieu de vie. Regardez dans toutes les pièces, les placards, la salle de bain, la cave, le grenier, le jardin, le garage. Il arrive souvent que la personne se soit simplement cachée ou endormie dans un endroit inhabituel.
- Collecte d’informations : Si la personne n’est pas sur place, notez immédiatement l’heure à laquelle vous avez constaté sa disparition. Essayez de vous souvenir de la dernière fois que vous l’avez vue et de ce qu’elle portait (couleurs, type de vêtements, chaussures, portait-elle un manteau ?). Préparez une photo récente.
La mobilisation du premier cercle
Agissez vite. N’attendez pas en pensant que la personne va revenir d’elle-même. Chaque minute compte. Contactez immédiatement les membres de la famille, les amis proches et les voisins. Donnez-leur une description précise et répartissez-vous les zones de recherche immédiates : les rues avoisinantes, le parc le plus proche, les commerces du quartier.
Quand et comment contacter les autorités ?
Il ne faut pas hésiter ni avoir honte de contacter les forces de l’ordre (Police ou Gendarmerie en composant le 17). Une disparition de personne vulnérable est toujours prise au sérieux. Nous vous conseillons de les appeler si vous n’avez pas retrouvé votre proche dans les 15 à 30 minutes suivant le début de vos recherches.
Lorsque vous les appelez, soyez prêt à fournir les informations suivantes de manière claire et concise :
- Identité complète : Nom, prénom, âge, date de naissance.
- Description physique : Taille, corpulence, couleur des cheveux et des yeux, signes distinctifs (lunettes, cicatrice, démarche particulière).
- Tenue vestimentaire : Description la plus précise possible des vêtements.
- Informations médicales : Précisez qu’il s’agit d’une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer, son état de santé général et si elle a besoin de médicaments urgents.
- Circonstances de la disparition : Heure et lieu de la dernière vue, ce qu’elle faisait juste avant.
- Destinations possibles : Mentionnez ses anciennes adresses, lieux de travail, ou tout lieu qu’elle a récemment évoqué.
Fournir une photo récente sera d’une aide précieuse. Les forces de l’ordre pourront ainsi diffuser un signalement rapidement et efficacement.
La recherche active : organiser les recherches méthodiquement
Une fois l’alerte donnée, la recherche s’organise. Il ne s’agit pas de courir dans tous les sens, mais de coordonner les efforts pour couvrir le plus de terrain possible de manière logique.
Définir les zones de recherche prioritaires
Il faut essayer de se mettre à la place de la personne. Où sa mémoire la guiderait-elle ? Les recherches doivent se concentrer en priorité sur les lieux qui ont un sens pour elle.
- Les chemins de la mémoire : Pensez aux lieux de son passé. L’ancienne maison familiale, l’école où elle allait, l’entreprise où elle a travaillé, même si ces lieux sont à plusieurs kilomètres. Les personnes atteintes de la maladie peuvent parfois parcourir des distances étonnamment longues, guidées par un souvenir puissant.
- Les habitudes récentes : Où aime-t-elle se promener ? Quel est son trajet habituel pour aller à la boulangerie ou au parc ? Explorez ces itinéraires familiers.
- Les points d’attraction et de danger : Vérifiez les parcs, les places publiques, les églises, les gares. Pensez également aux zones à risque comme les bords de rivière, les étangs, les voies ferrées ou les routes à grande circulation.
Les outils et ressources à votre disposition
En plus de l’action de la police ou de la gendarmerie, d’autres ressources peuvent être mobilisées. Les associations de soutien aux familles, comme France Alzheimer, peuvent offrir des conseils précieux et un soutien moral. Elles disposent d’une grande expérience de ces situations et peuvent vous aider à ne rien oublier. Les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour diffuser un avis de recherche (avec l’accord de la famille et en veillant à ne pas partager d’informations trop personnelles), en ciblant les groupes locaux de votre ville ou de votre quartier.
Le rôle de la communauté : l’union fait la force
N’hésitez pas à informer les commerçants du quartier, le pharmacien, le médecin, le facteur. Montrez-leur une photo. Ce sont des personnes qui sont souvent dehors et qui peuvent avoir aperçu votre proche. La vigilance collective d’une communauté est une aide inestimable. Les gens sont souvent bien plus disposés à aider qu’on ne l’imagine, surtout lorsqu’il s’agit d’une personne vulnérable.
Après la fugue : le retour et l’analyse pour l’avenir
Le moment où l’on retrouve la personne est un immense soulagement, mais la gestion de la situation ne s’arrête pas là. L’après-fugue est une étape essentielle pour le bien-être de la personne et pour renforcer la prévention future.
Accueillir la personne sans jugement
Lorsque votre proche est retrouvé, il est probablement fatigué, effrayé, confus, et peut-être même en hypothermie ou déshydraté. La priorité absolue est de le rassurer. Évitez les reproches, les questions accusatrices (“Mais pourquoi es-tu parti ?”). La personne n’a probablement pas de réponse logique à vous donner et cela ne ferait qu’augmenter son angoisse. Accueillez-la avec chaleur, offrez-lui une boisson chaude, une couverture, et parlez-lui d’une voix calme. Faites-la examiner par un médecin pour vous assurer qu’elle n’est pas blessée.
Analyser l’événement pour mieux prévenir
Une fois que tout le monde a retrouvé son calme, il est important de faire le point, non pas pour trouver un coupable, mais pour comprendre. Essayez de reconstituer le fil des événements qui ont précédé la fugue.
- Y a-t-il eu un changement dans la routine ce jour-là ?
- La personne a-t-elle montré des signes d’agitation, d’anxiété ou de douleur ?
- Avait-elle exprimé verbalement ou non-verbalement un besoin particulier ?
- Y a-t-il eu un élément déclencheur dans l’environnement (un bruit fort, une visite) ?
Cette analyse vous permettra d’identifier d’éventuelles failles dans votre filet de sécurité et d’ajuster vos stratégies de prévention. Peut-être faut-il renforcer la sécurisation d’une porte, ou être plus attentif aux signes de douleur, ou encore enrichir les journées avec plus d’activités structurées et de moments de partage.
Prendre soin de soi en tant qu’aidant
Enfin, n’oubliez pas de prendre soin de vous. Une fugue est un événement traumatisant pour l’aidant. Le stress, la peur et la culpabilité peuvent être écrasants. Il est essentiel de ne pas rester seul avec ces émotions. Parlez-en à votre famille, à des amis, ou rejoignez un groupe de parole pour aidants. Vous pouvez également trouver des informations et du soutien sur des portails officiels comme le site Pour les personnes âgées du gouvernement. Reconnaître votre propre fatigue et votre stress est la première étape pour pouvoir continuer à accompagner votre proche de manière sereine et efficace.
Chez nous, nous croyons fermement que l’information, la prévention et les bons outils peuvent transformer l’angoisse en vigilance, et la peur en action réfléchie. La route avec la maladie d’Alzheimer est un chemin semé d’imprévus, mais en étant préparé, soutenu et équipé, vous ne marchez jamais seul.
Dans le cadre de la discussion sur la “Fugue d’une personne Alzheimer : protocole d’alerte et recherche”, il est intéressant de considérer les outils et ressources disponibles pour les professionnels de santé, notamment les orthophonistes, qui jouent un rôle crucial dans l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Un article pertinent à ce sujet peut être trouvé sur le site de Dynseo, qui propose des solutions adaptées pour les orthophonistes. Pour en savoir plus sur ces ressources, vous pouvez consulter cet article dédié aux orthophonistes.