L’agitation chez la personne âgée représente l’un des défis les plus complexes et éprouvants auxquels sont confrontés les professionnels de santé et les aidants familiaux. Manifestation comportementale aux multiples facettes, l’agitation se caractérise par une activité motrice excessive, souvent inappropriée, accompagnée d’une détresse émotionnelle importante. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’agitation n’est pas un symptôme isolé ni une conséquence inévitable du vieillissement, mais bien un signal d’alarme indiquant un besoin non satisfait ou une souffrance sous-jacente.
Dans le contexte des pathologies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la démence à corps de Lewy ou la maladie de Parkinson, l’agitation constitue l’un des troubles du comportement les plus fréquents et les plus difficiles à gérer. Elle peut prendre diverses formes : verbale avec des cris, des plaintes répétitives ou des insultes, physique avec des comportements agressifs, motrice avec une déambulation incessante ou des gestes répétitifs. Chaque manifestation d’agitation a un sens et répond à une cause qu’il est essentiel d’identifier pour proposer une réponse adaptée.
Ce guide complet explore en profondeur les mécanismes de l’agitation chez la personne âgée, propose des outils d’évaluation pratiques et détaille les interventions non médicamenteuses qui ont prouvé leur efficacité. Notre objectif est de vous fournir les clés pour comprendre et gérer ces situations difficiles tout en préservant la qualité de vie de la personne agitée et de son entourage.
Comprendre l’agitation : définition et manifestations
Qu’est-ce que l’agitation ?
L’agitation se définit comme une activité motrice, verbale ou vocale excessive et inappropriée qui ne peut pas s’expliquer par un besoin évident ou par une confusion. Elle représente une réponse inadaptée à un stimulus interne ou externe et s’accompagne généralement d’une détresse émotionnelle significative pour la personne qui la manifeste.
Il est fondamental de comprendre que l’agitation n’est pas un comportement volontaire ou manipulateur. La personne agitée ne cherche pas à « embêter » son entourage ou à « faire des caprices ». Dans le contexte des troubles cognitifs, l’agitation constitue souvent le seul moyen d’expression dont dispose la personne pour communiquer un malaise, une douleur, une peur, ou un besoin non satisfait. C’est un langage non verbal qu’il faut apprendre à décoder.
L’agitation se distingue de l’agressivité, bien que les deux puissent coexister. Une personne peut être agitée sans être agressive, et inversement. L’agitation reflète davantage un état d’hyperactivité et de tension interne, tandis que l’agressivité implique une intentionnalité dirigée vers autrui ou vers soi-même.
Les différentes formes d’agitation
L’agitation chez la personne âgée peut se manifester sous diverses formes, et il est courant qu’une même personne présente plusieurs types d’agitation simultanément ou successivement.
L’agitation verbale se caractérise par des vocalisations excessives qui peuvent prendre plusieurs formes. Les cris et les hurlements sans raison apparente sont fréquents, particulièrement en fin d’après-midi ou le soir (phénomène du « sundowning »). Les plaintes répétitives sur des sujets variés (douleur, inconfort, envie de rentrer chez soi) constituent une autre manifestation courante. Les questions incessantes, posées de manière répétitive malgré les réponses données, traduisent souvent une anxiété sous-jacente. Les insultes ou les propos déplacés peuvent également survenir, particulièrement difficiles à vivre pour l’entourage qui doit comprendre qu’ils ne reflètent pas les véritables sentiments de la personne mais sont liés à la maladie.
L’agitation motrice englobe toutes les manifestations physiques de suractivité. La déambulation incessante, où la personne marche sans but apparent pendant des heures, est très fréquente et épuisante tant pour la personne que pour son entourage. Les gestes répétitifs comme se frotter les mains, tirer sur ses vêtements, ouvrir et fermer des tiroirs de manière compulsive, font partie de ce tableau. L’incapacité à rester assis tranquillement, avec un besoin constant de se lever et de bouger, rend les moments de repos difficiles. Les tentatives répétées de sortir ou de « rentrer chez soi », même lorsque la personne est déjà à son domicile, reflètent souvent un sentiment de déracinement ou une recherche de sécurité.
L’agitation agressive représente la forme la plus préoccupante, tant pour la sécurité de la personne que pour celle de son entourage. Elle peut être physique, avec des coups, des pincements, des morsures, des griffures, ou des jets d’objets. Elle peut aussi être verbale, avec des menaces, des insultes violentes, ou des cris menaçants. Cette forme d’agitation survient généralement lorsque la personne se sent menacée, acculée, ou incomprise, et qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen de communication pour exprimer son malaise.
L’agitation nocturne mérite une mention particulière car elle perturbe profondément le sommeil de tous et constitue une cause majeure d’épuisement des aidants. Elle se manifeste par des réveils fréquents, une déambulation nocturne, des cris ou des pleurs pendant la nuit, et une inversion du rythme veille-sommeil où la personne dort le jour et reste éveillée la nuit.
Épidémiologie et populations concernées
L’agitation touche une proportion importante des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs. Les études épidémiologiques montrent que 40 à 60% des personnes atteintes de maladie d’Alzheimer présentent des épisodes d’agitation au cours de l’évolution de leur maladie. Cette prévalence augmente avec la sévérité de la démence et concerne jusqu’à 70-90% des personnes aux stades avancés.
Dans les structures d’hébergement pour personnes âgées, l’agitation constitue l’un des troubles du comportement les plus fréquents et l’une des principales causes de recours aux psychotropes. Elle représente également l’un des facteurs majeurs de stress pour les équipes soignantes et peut conduire à des situations de maltraitance involontaire si les professionnels ne sont pas formés à la gérer.
L’impact de l’agitation va bien au-delà de la personne elle-même. C’est l’un des facteurs prédictifs les plus importants de l’épuisement des aidants familiaux et de la décision d’institutionnalisation. Les aidants confrontés à l’agitation de leur proche rapportent des niveaux élevés de stress, d’anxiété, de dépression, et une détérioration significative de leur propre santé.
Les causes multifactorielles de l’agitation
Facteurs médicaux et physiologiques
L’agitation chez la personne âgée est rarement sans cause médicale sous-jacente. L’un des premiers réflexes face à une agitation nouvelle ou qui s’aggrave doit être de rechercher une cause physiologique traitable.
La douleur est l’une des causes les plus fréquentes d’agitation, particulièrement chez les personnes ayant des difficultés à s’exprimer verbalement. Une douleur dentaire, une arthrose invalidante, une fracture non diagnostiquée, une constipation sévère, une infection urinaire, ou toute autre source de douleur peut se manifester par de l’agitation. Le problème est que les personnes atteintes de troubles cognitifs avancés ne peuvent souvent plus localiser ou verbaliser leur douleur, et celle-ci s’exprime alors uniquement par des modifications comportementales.
Les infections constituent une autre cause majeure. Les infections urinaires, extrêmement fréquentes chez les personnes âgées, peuvent se manifester principalement par de l’agitation avant même que n’apparaissent des signes urinaires évidents. Les infections respiratoires, les infections cutanées, et toute autre infection peuvent également déclencher ou aggraver une agitation.
Les troubles métaboliques comme la déshydratation (très fréquente chez les seniors qui ne ressentent plus la soif), l’hypoglycémie ou l’hyperglycémie chez les diabétiques, les déséquilibres électrolytiques, ou les dysfonctionnements thyroïdiens peuvent tous se manifester par de l’agitation.
La iatrogénie médicamenteuse, c’est-à-dire les effets indésirables des médicaments, est une cause souvent négligée. Certains médicaments peuvent induire ou aggraver l’agitation : les anticholinergiques (utilisés pour l’incontinence, les allergies, certains troubles psychiatriques), les corticoïdes, certains antiparkinsoniens, les benzodiazépines (paradoxalement), et de nombreux autres. L’addition de plusieurs médicaments (polymédication) augmente considérablement le risque d’effets indésirables.
Les troubles sensoriels contribuent également à l’agitation. Une baisse de l’acuité visuelle non corrigée crée de l’anxiété et de la confusion, tout comme une surdité non appareillée qui isole la personne et la coupe de son environnement.
La constipation mérite une mention spéciale tant elle est fréquente, inconfortable, et souvent négligée chez les personnes âgées. Un fécalome (accumulation de selles dures dans le rectum) peut provoquer une agitation importante.
Facteurs environnementaux et sensoriels
L’environnement dans lequel évolue la personne âgée joue un rôle crucial dans l’apparition et l’intensité de l’agitation. Un environnement inadapté peut être source de stress constant et de confusion.
La sur-stimulation sensorielle est particulièrement problématique. Un environnement bruyant (télévision forte, conversations multiples, sonneries fréquentes, alarmes), trop lumineux, ou avec trop d’activité simultanée peut submerger les capacités de traitement de l’information d’une personne atteinte de troubles cognitifs. Cette surcharge sensorielle génère de l’anxiété et de l’agitation.
À l’inverse, la sous-stimulation avec un environnement monotone, sans activités ni interactions sociales, peut également conduire à de l’agitation. L’ennui et le manque de stimulation cognitive et sociale créent un vide que la personne tente de combler par de l’agitation motrice ou verbale.
Les changements d’environnement sont particulièrement déstabilisants. Un déménagement, une hospitalisation, un changement de chambre ou même un réaménagement de l’espace familier peuvent déclencher une agitation importante. Les personnes atteintes de troubles cognitifs ont besoin de repères stables et prévisibles.
La température ambiante mérite attention. Un environnement trop chaud ou trop froid génère de l’inconfort que la personne peut avoir du mal à identifier et à exprimer autrement que par de l’agitation.
L’inconfort physique lié à l’environnement doit être systématiquement évalué : vêtements trop serrés ou inconfortables, fauteuil inadapté, literie inconfortable, position inadéquate maintenue trop longtemps.
Facteurs psychologiques et émotionnels
Au-delà des causes médicales et environnementales, l’état émotionnel et psychologique de la personne joue un rôle central dans l’agitation.
L’anxiété est probablement le facteur psychologique le plus fréquemment associé à l’agitation. Les personnes atteintes de troubles cognitifs vivent dans un monde devenu incompréhensible et imprévisible. Elles ne reconnaissent plus les lieux, ne comprennent plus les situations, perdent leurs repères temporels, et peuvent ne plus reconnaître leurs proches. Cette perte de contrôle et cette confusion génèrent une anxiété profonde qui s’exprime par de l’agitation.
La peur est également très présente. Peur de l’abandon (très fréquente, même en présence constante de proches), peur des soins perçus comme des agressions, peur de personnes non reconnues et donc perçues comme des étrangers menaçants, peur de situations nouvelles ou incomprises.
La frustration naît de l’incapacité à communiquer efficacement, à réaliser des tâches autrefois simples, ou à obtenir ce que l’on souhaite. Cette frustration s’accumule et peut exploser en agitation.
La dépression est fréquente chez les personnes atteintes de troubles cognitifs, particulièrement aux stades précoces où elles ont conscience de leurs difficultés. Cette dépression peut se manifester non pas par de la tristesse exprimée, mais par de l’agitation, de l’irritabilité, et de l’agressivité.
Les réactions catastrophiques constituent un phénomène particulier où la personne réagit de manière disproportionnée à un stimulus mineur. Une demande simple comme « viens prendre ton bain » peut déclencher une réaction de panique intense avec agitation majeure. Ces réactions surviennent lorsque la personne se sent dépassée par une situation qu’elle ne comprend pas ou qu’elle perçoit comme menaçante.
Besoins non satisfaits et communication
Un principe fondamental pour comprendre l’agitation est que chaque comportement est une forme de communication. Lorsqu’une personne atteinte de troubles cognitifs ne peut plus exprimer verbalement ses besoins, l’agitation devient son langage.
Les besoins physiologiques de base sont souvent à l’origine de l’agitation : faim, soif, besoin d’aller aux toilettes, fatigue, douleur, inconfort physique. Une personne qui ne peut plus dire « j’ai faim » ou « j’ai mal » va l’exprimer par de l’agitation.
Le besoin de sécurité est fondamental. Lorsqu’une personne se sent en danger (réel ou perçu), son système d’alarme s’active et génère de l’agitation. Ce besoin de sécurité inclut aussi le besoin de routine et de prévisibilité.
Le besoin d’appartenance et de connexion sociale persiste même aux stades avancés de la démence. L’isolement, la solitude, le sentiment de ne pas être compris ou reconnu génèrent de la détresse et de l’agitation.
Le besoin de sens et d’activité reste présent. Même avec des capacités cognitives limitées, les personnes ont besoin de se sentir utiles, d’avoir un rôle, de participer à des activités significatives. L’ennui et le sentiment d’inutilité peuvent se manifester par de l’agitation.
Le besoin de confort émotionnel inclut le besoin de réassurance, de tendresse, de contacts affectifs positifs. L’absence de ces éléments crée un vide émotionnel que la personne tente de combler.
Évaluation de l’agitation : outils et démarche systématique
L’observation structurée
Face à une personne agitée, la première étape consiste à observer de manière systématique et structurée les manifestations de l’agitation et leur contexte. Une observation rigoureuse est essentielle pour identifier les causes et adapter les interventions.
Le journal d’observation constitue un outil précieux. Il s’agit de noter, sur plusieurs jours, les épisodes d’agitation avec les informations suivantes : date et heure de survenue, durée de l’épisode, description précise du comportement observé (cris, déambulation, gestes agressifs, etc.), contexte de survenue (pendant les soins, après une visite, au moment des repas, etc.), et réactions de l’entourage. Ce journal permet de dégager des patterns, d’identifier des déclencheurs récurrents, et d’évaluer l’efficacité des interventions mises en place.
L’analyse ABC (Antécédent-Behavior-Consequence) est une méthode structurée d’observation comportementale particulièrement utile. Elle consiste à analyser trois éléments :
- A (Antécédent) : Qu’est-ce qui s’est passé juste avant l’épisode d’agitation ? Où était la personne ? Qui était présent ? Quelle activité était en cours ?
- B (Behavior/Comportement) : Description précise du comportement agité observé.
- C (Conséquence) : Qu’est-ce qui s’est passé juste après ? Comment l’entourage a-t-il réagi ? Quel a été le résultat de l’intervention ?
Cette analyse permet d’identifier les déclencheurs de l’agitation et les facteurs qui la maintiennent ou l’aggravent.
L’identification des patterns temporels est cruciale. Certaines agitations surviennent à des moments précis de la journée : le matin au réveil, en fin d’après-midi (sundowning), pendant les soins, aux heures des repas, la nuit. Reconnaître ces patterns permet d’anticiper et de prévenir l’agitation.
Échelles d’évaluation standardisées
Plusieurs échelles validées permettent d’évaluer l’agitation de manière standardisée, facilitant la communication entre professionnels et le suivi de l’évolution.
L’échelle CMAI (Cohen-Mansfield Agitation Inventory) est l’une des plus utilisées. Elle évalue 29 comportements d’agitation répartis en trois catégories : agitation physique non agressive (déambulation, activités répétitives, manipulation d’objets), agitation physique agressive (coups, morsures, griffures), et agitation verbale (cris, plaintes, négativisme verbal). Chaque comportement est coté selon sa fréquence d’apparition sur une échelle de 1 (jamais) à 7 (plusieurs fois par heure).
L’échelle NPI (Neuropsychiatric Inventory) évalue plus largement les troubles neuropsychiatriques incluant l’agitation, mais aussi l’agressivité, la dépression, l’anxiété, l’apathie et d’autres symptômes. Elle prend en compte à la fois la fréquence et la sévérité des symptômes, ainsi que le retentissement sur l’aidant.
L’échelle BEHAVE-AD (Behavioral Pathology in Alzheimer’s Disease Rating Scale) est spécifiquement conçue pour évaluer les troubles du comportement dans la maladie d’Alzheimer, incluant différentes formes d’agitation.
Ces échelles, bien que conçues pour la recherche, peuvent être adaptées pour un usage clinique et permettent d’objectiver l’agitation et de suivre son évolution au fil du temps.
Recherche des causes médicales
Face à toute agitation nouvelle ou qui s’aggrave, une évaluation médicale complète est indispensable avant d’envisager toute intervention.
L’examen clinique doit rechercher systématiquement des signes de douleur (en utilisant des échelles d’hétéro-évaluation de la douleur chez les personnes non communicantes), des signes d’infection (fièvre, toux, dysurie), des signes de déshydratation, une constipation ou un fécalome, des troubles sensoriels (vision, audition).
Les examens complémentaires peuvent inclure : une analyse d’urine (recherche d’infection), un bilan sanguin (recherche d’anémie, de troubles métaboliques, de signes infectieux), une radiographie pulmonaire si suspicion d’infection respiratoire, d’autres examens selon l’orientation clinique.
La revue médicamenteuse est systématique. Tous les médicaments pris par la personne doivent être listés et analysés pour identifier d’éventuels effets indésirables ou interactions. Les modifications récentes de traitement doivent être particulièrement examinées.
L’examen dentaire ne doit pas être oublié. Les problèmes dentaires sont fréquents, douloureux, et souvent négligés chez les personnes âgées ayant des troubles cognitifs.
Évaluation des facteurs environnementaux et psychosociaux
Parallèlement à l’évaluation médicale, une analyse approfondie de l’environnement et du contexte psychosocial est nécessaire.
L’analyse de l’environnement physique examine le niveau sonore, l’éclairage, la température, l’encombrement, la sécurité, l’adaptation du mobilier, l’accessibilité des toilettes, la présence de repères visuels.
L’évaluation des routines et du rythme de vie regarde l’organisation de la journée, les heures de lever et de coucher, les moments de stimulation et de repos, la prévisibilité des activités, le respect des habitudes de vie antérieures.
L’analyse des interactions sociales s’intéresse à la qualité et la fréquence des interactions avec les aidants, le style de communication utilisé, la manière dont les soins sont prodigués, les réactions de l’entourage face à l’agitation.
L’évaluation de l’état émotionnel tente d’identifier l’anxiété, la dépression, la peur, la frustration, l’ennui, en utilisant l’observation comportementale et des échelles adaptées aux personnes non communicantes.
Interventions non médicamenteuses : l’approche de première ligne
Principes généraux des interventions
Avant de détailler les différentes stratégies, il est essentiel de poser les principes généraux qui guident toute intervention face à l’agitation.
Le principe de non-nuisance est primordial. Toute intervention doit d’abord viser à ne pas aggraver la situation. Certaines réactions instinctives face à l’agitation (contraindre physiquement, isoler, réprimander) peuvent non seulement être inefficaces mais aussi dangereuses et augmenter l’agitation.
L’approche personnalisée reconnaît que chaque personne est unique, avec son histoire de vie, sa personnalité, ses préférences, et ses déclencheurs spécifiques. Ce qui fonctionne pour une personne peut être inefficace ou contre-productif pour une autre. Il est donc essentiel de connaître la personne, son parcours de vie, ses goûts, ses habitudes, pour adapter les interventions.
La prévention est toujours préférable à la gestion de crise. Identifier les déclencheurs et intervenir en amont permet d’éviter de nombreux épisodes d’agitation. Une approche proactive qui anticipe les besoins et les situations à risque est bien plus efficace qu’une approche réactive.
La patience et la bienveillance sont des qualités essentielles. L’agitation n’est pas intentionnelle et ne doit jamais être punie ou réprimandée. La personne agitée souffre et a besoin de compréhension, de réassurance, et de soutien.
L’approche multidimensionnelle reconnaît que l’agitation a généralement plusieurs causes et nécessite donc plusieurs types d’interventions combinées, agissant sur les différents facteurs identifiés.
Optimisation de l’environnement
Créer un environnement adapté constitue l’une des interventions les plus efficaces pour prévenir et réduire l’agitation.
La réduction de la stimulation excessive passe par plusieurs mesures : diminuer le bruit ambiant (baisser la télévision ou l’éteindre, limiter les conversations multiples simultanées), créer des zones calmes où la personne peut se retirer, limiter le nombre de personnes présentes simultanément, éviter les environnements trop animés ou chaotiques.
L’amélioration de l’éclairage joue un rôle important. Un éclairage naturel suffisant pendant la journée aide à maintenir le rythme circadien. Un éclairage adapté en soirée évite les ombres et les zones sombres qui peuvent être source d’anxiété. Des veilleuses la nuit sécurisent les déplacements.
La création de repères aide la personne à se situer dans l’espace et le temps. Des horloges visibles, des calendriers, des photos familières sur les murs, des panneaux indicateurs pour les toilettes ou la chambre, des couleurs différentes pour les différentes zones peuvent tous servir de repères rassurants.
La sécurisation de l’espace permet à la personne de se déplacer librement sans danger. L’élimination des obstacles, la sécurisation des zones à risque, l’accès facile aux toilettes, la visibilité des espaces réduisent l’anxiété et les situations dangereuses.
La personnalisation de l’espace avec des objets familiers, des photos de famille, des souvenirs significatifs crée un sentiment d’appartenance et de confort qui diminue l’agitation.
Stratégies de communication adaptées
La manière dont nous communiquons avec une personne agitée peut soit apaiser soit aggraver la situation. Une communication adaptée est un outil thérapeutique en soi.
L’approche calme et non menaçante est fondamentale. Se présenter face à la personne (éviter d’arriver par derrière), se mettre à sa hauteur, maintenir une distance respectueuse (ni trop proche ni trop loin), adopter une posture ouverte et détendue, établir un contact visuel doux.
Le ton de voix doit être calme, posé, rassurant, avec un débit lent. Même si la personne ne comprend plus toujours les mots, elle perçoit l’émotion transmise par le ton. Une voix douce et apaisante a un effet calmant.
La simplicité du message est cruciale. Utiliser des phrases courtes, un vocabulaire simple, un seul message à la fois. Éviter les explications complexes, les choix multiples, les questions ouvertes qui peuvent submerger la personne.
La validation émotionnelle consiste à reconnaître et à légitimer les émotions de la personne sans nécessairement valider le contenu confus de son discours. Par exemple, si une personne demande de manière agitée à voir sa mère décédée depuis longtemps, plutôt que de rappeler brutalement le décès (« ta mère est morte depuis 20 ans »), on peut valider l’émotion (« je vois que tu as envie de voir ta maman, elle te manque beaucoup »).
L’utilisation du non-verbal est puissante. Un sourire, un toucher doux sur l’épaule ou la main (si la personne l’accepte), un hochement de tête compréhensif transmettent souvent plus que les mots.
La distraction et la redirection sont des techniques très utiles. Face à une agitation, plutôt que de s’opposer ou de raisonner, on peut détourner l’attention vers quelque chose d’apaisant ou d’intéressant. « Viens, on va regarder les photos ensemble » peut être plus efficace que toute argumentation logique.
Gestion de la routine et des activités
Structurer la journée avec des routines prévisibles et des activités adaptées prévient efficacement l’agitation.
L’établissement de routines quotidiennes procure des repères temporels et réduit l’anxiété. Les moments clés (lever, toilette, repas, activités, repos, coucher) doivent se dérouler à des heures régulières et selon des séquences prévisibles. Cette prévisibilité crée un sentiment de sécurité.
L’adaptation des activités est essentielle. Les activités doivent être à la fois stimulantes pour éviter l’ennui mais pas trop complexes pour éviter la frustration. Elles doivent correspondre aux capacités actuelles de la personne et idéalement s’appuyer sur ses anciens centres d’intérêt et compétences.
Les programmes de stimulation cognitive comme EDITH de DYNSEO sont particulièrement adaptés pour les personnes âgées atteintes de pathologies neurodégénératives. EDITH propose plus de 30 jeux et activités cognitives conçus spécifiquement pour les seniors, avec des niveaux de difficulté ajustables. Ces activités stimulent la mémoire, l’attention, le langage et les fonctions exécutives tout en restant ludiques et motivantes.
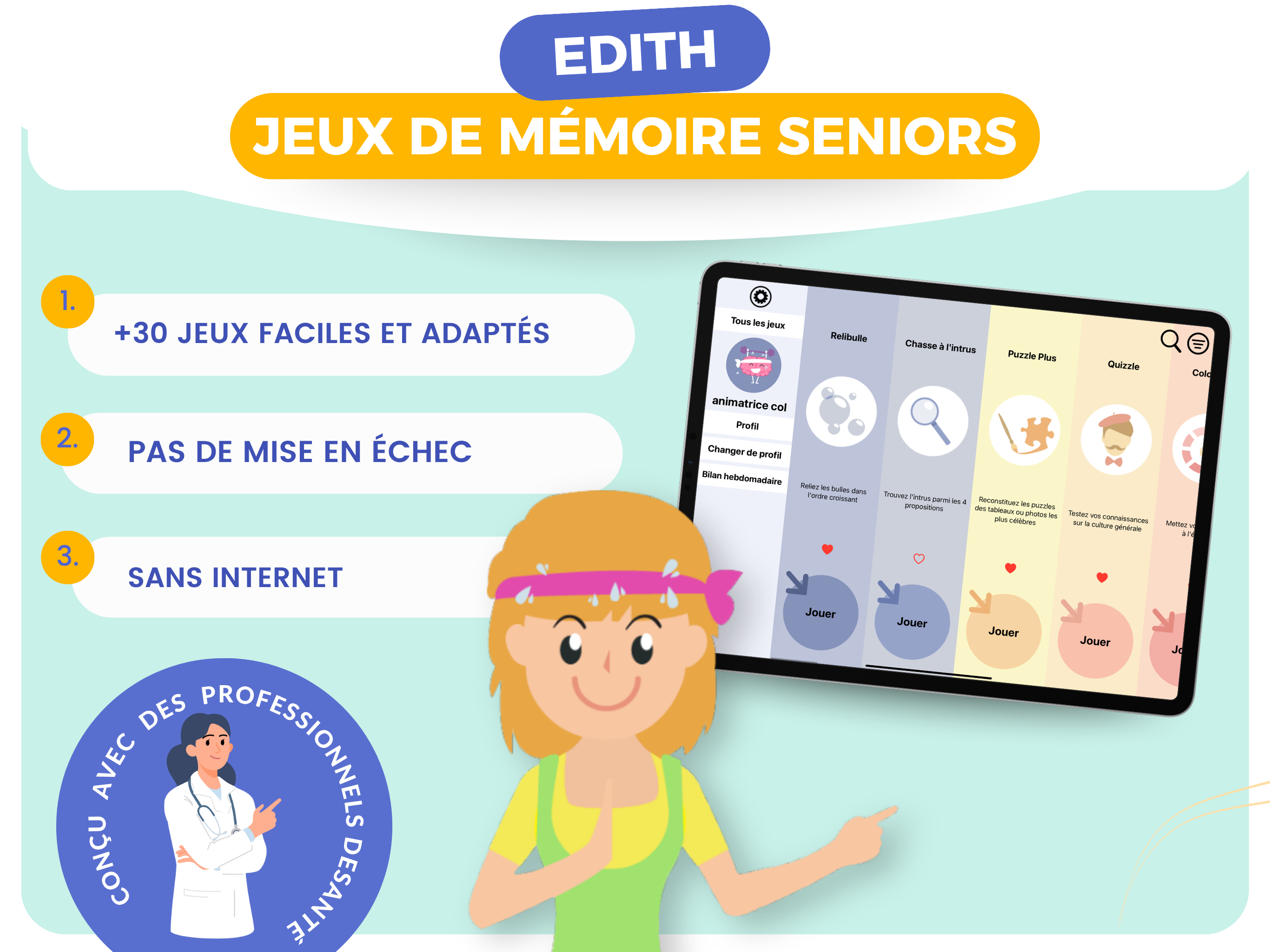
L’avantage d’un programme structuré comme EDITH est double : d’une part, il offre une stimulation cognitive régulière qui peut contribuer à réduire l’agitation en occupant la personne de manière constructive ; d’autre part, les routines d’utilisation créent des repères temporels rassurants. Les séances peuvent être courtes (10-15 minutes) et réalisées à des moments stratégiques de la journée pour prévenir l’agitation.
L’activité physique adaptée a démontré son efficacité pour réduire l’agitation. Des promenades quotidiennes, même courtes, de la gymnastique douce, de la danse adaptée, ou simplement des mouvements rythmés sur de la musique peuvent canaliser l’énergie et réduire la tension.
Les activités sensorielles procurent souvent un apaisement important. La musicothérapie (écouter de la musique familière, particulièrement de la jeunesse de la personne), l’aromathérapie (avec précaution), les jardins sensoriels, les activités de toucher (manipulation de tissus, de laine, de pâte à modeler), les activités visuelles (regarder des photos, des vidéos familiales) engagent les sens de manière apaisante.
Les pauses et les temps de repos doivent être intégrés à la journée. Une personne fatiguée est plus susceptible d’être agitée. Des moments calmes, dans un environnement apaisant, permettent de recharger les batteries.
Approches corporelles et sensorielles
Le corps joue un rôle central dans l’agitation, et des approches ciblant le bien-être physique peuvent être très efficaces.
Le massage et le toucher thérapeutique, pratiqués avec douceur et respect, peuvent procurer un apaisement significatif. Un massage des mains, des épaules, ou des pieds peut réduire la tension physique et émotionnelle. Le toucher transmet aussi une présence réconfortante et une connexion humaine.
La relaxation et la respiration peuvent être guidées même auprès de personnes ayant des troubles cognitifs. Des exercices simples de respiration profonde, guidés par la voix et l’exemple, peuvent aider à réduire l’agitation.
L’hydrothérapie, lorsqu’elle est possible, offre souvent des moments d’apaisement. Un bain tiède, pas trop chaud, dans une ambiance calme, peut détendre considérablement. Attention cependant car le bain peut aussi être source d’anxiété pour certaines personnes.
La luminothérapie peut être utile, particulièrement pour l’agitation liée aux perturbations du rythme circadien. Une exposition à une lumière vive le matin peut aider à réguler le rythme veille-sommeil et réduire l’agitation vésperale.
Gestion des situations de crise
Malgré toutes les mesures préventives, des situations de crise aiguë peuvent survenir. Savoir y faire face de manière appropriée est crucial pour la sécurité de tous.
La priorité à la sécurité est absolue. Si la situation devient dangereuse (agressivité physique importante), il faut assurer la sécurité de la personne agitée, des autres personnes présentes, et de soi-même. Cela peut nécessiter de s’éloigner temporairement, d’appeler du renfort, ou dans des cas extrêmes, de contacter les services d’urgence.
Le maintien du calme de l’intervenant est essentiel. Une personne agitée perçoit l’anxiété ou la colère de son interlocuteur, ce qui aggrave la situation. Respirer profondément, parler d’une voix calme, ne pas montrer de peur ou d’agacement sont des compétences cruciales.
L’évitement de la confrontation et de l’argumentation logique est important. On ne « gagne » pas contre une personne en crise agitée en ayant raison. Mieux vaut valider les émotions, chercher à comprendre le besoin sous-jacent, et proposer des alternatives.
La création d’un espace sûr où la personne peut se calmer, loin de la sur-stimulation, est souvent bénéfique. Ce n’est pas un isolement punitif mais l’offre d’un refuge apaisant.
L’analyse post-crise est fondamentale pour apprendre et prévenir les récidives. Une fois la situation calmée, prendre le temps de réfléchir à ce qui s’est passé, aux déclencheurs, à ce qui a fonctionné ou pas dans l’intervention, permet d’améliorer les pratiques.
Formation et accompagnement des aidants
L’importance de la formation
Face à l’agitation d’un proche ou d’un patient, les aidants peuvent se sentir démunis, épuisés, et parfois tentés de réagir de manière inadaptée. La formation est donc un élément clé d’une prise en charge de qualité.
Pour les professionnels de santé, DYNSEO propose une formation complète : « Troubles du comportement liés à la maladie : méthodes et coordination pluridisciplinaire ». Cette formation approfondit la compréhension des mécanismes des troubles du comportement incluant l’agitation, propose des stratégies d’intervention fondées sur les preuves, et aborde la coordination entre les différents acteurs de soins.
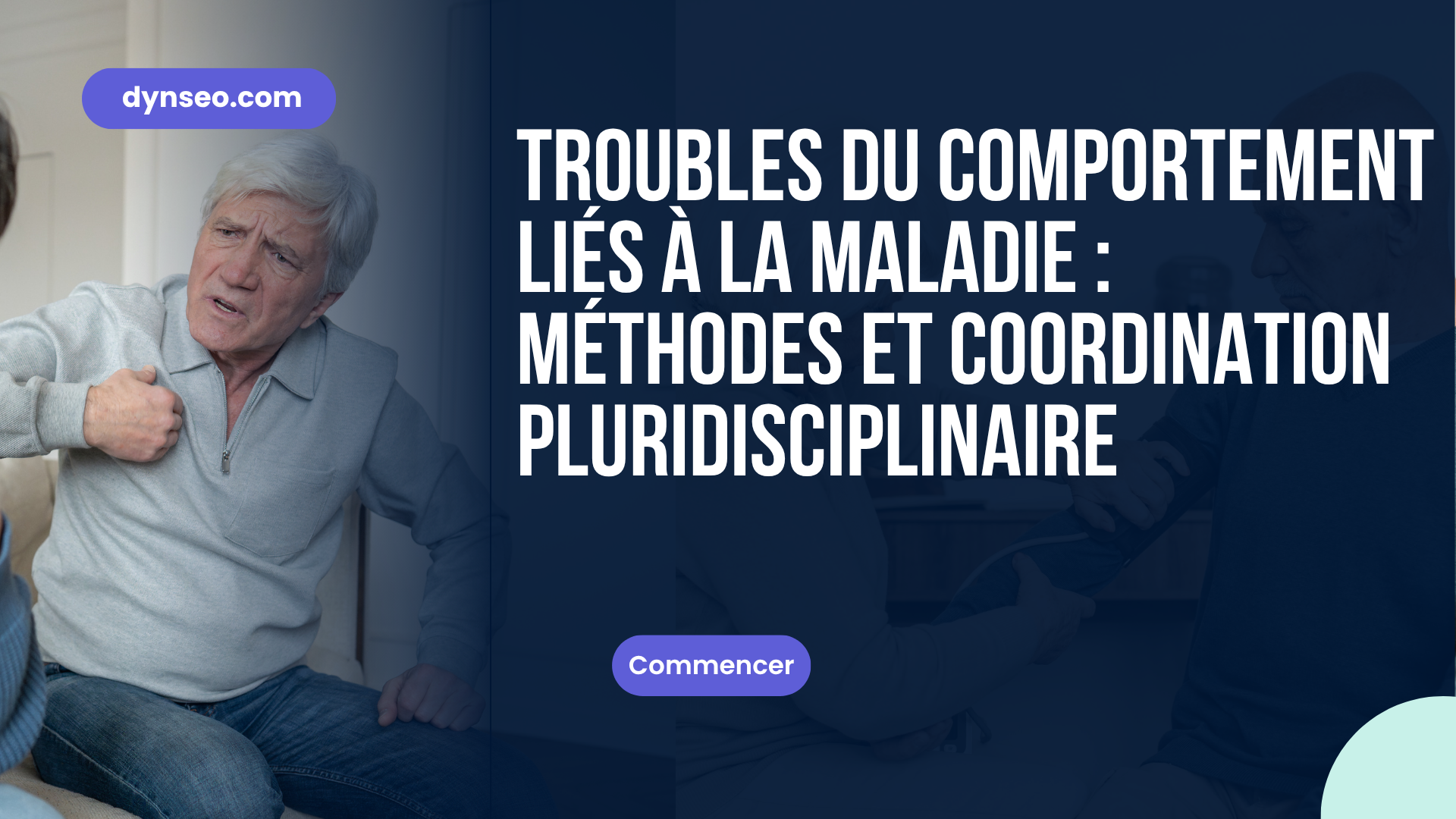
Cette formation permet aux infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie, ergothérapeutes, psychomotriciens et autres professionnels d’acquérir des compétences pratiques pour gérer l’agitation au quotidien. Elle couvre les approches de communication adaptée, les techniques de désescalade, la gestion des situations de crise, et l’importance de l’approche non médicamenteuse en première intention.
Pour les familles et les proches aidants, DYNSEO a développé la formation « Changements de comportement liés à la maladie : guide pratique pour les proches ». Cette formation aide les familles à comprendre pourquoi leur proche présente de l’agitation et comment y répondre de manière efficace et bienveillante.

Cette formation aborde des questions essentielles : pourquoi mon proche est-il agité ? Comment communiquer avec lui ? Que faire face à une crise ? Comment préserver ma propre santé face au stress de l’accompagnement ? Elle offre des outils concrets et directement applicables dans la vie quotidienne.
Le soutien aux aidants
Au-delà de la formation, les aidants ont besoin de soutien continu pour faire face aux défis de l’agitation.
Le répit régulier est indispensable. S’occuper d’une personne régulièrement agitée est épuisant physiquement et émotionnellement. Les solutions de répit (accueil de jour, hébergement temporaire, intervention de professionnels à domicile) permettent aux aidants de souffler régulièrement, ce qui est essentiel pour tenir sur la durée et préserver leur propre santé.
Les groupes de parole et d’entraide offrent un espace pour partager son expérience, se sentir compris, échanger des astuces, et briser l’isolement. Rencontrer d’autres personnes qui vivent des situations similaires normalise l’expérience et apporte du réconfort.
Le soutien psychologique peut être nécessaire. Accompagner une personne agitée peut générer du stress, de l’anxiété, de la culpabilité, de la colère, de la tristesse. Un psychologue peut aider l’aidant à gérer ces émotions difficiles et à développer des stratégies d’adaptation.
L’information et les ressources doivent être facilement accessibles. Les aidants ont besoin de savoir où trouver de l’aide, quels services existent, quelles aides financières sont disponibles.
La coordination pluridisciplinaire
La gestion de l’agitation ne peut être l’affaire d’une seule personne ou d’une seule discipline. Une approche coordonnée et pluridisciplinaire est nécessaire.
Le médecin traitant joue un rôle central dans l’évaluation médicale, l’exclusion des causes organiques, l’ajustement des traitements médicamenteux si nécessaire.
Le neurologue ou le gériatre apporte son expertise sur la pathologie neurodégénérative sous-jacente et peut proposer des stratégies thérapeutiques spécifiques.
L’infirmière assure le suivi régulier, l’évaluation des symptômes, la coordination des soins, l’éducation de la famille.
Le psychologue évalue les aspects psychologiques et émotionnels, propose des interventions comportementales, soutient les aidants.
L’ergothérapeute analyse l’environnement et propose des adaptations pour réduire l’agitation.
Le psychomotricien propose des activités corporelles et sensorielles adaptées.
Les aides-soignants et auxiliaires de vie sont en première ligne au quotidien et doivent être formés aux techniques de gestion de l’agitation.
Les pharmaciens peuvent alerter sur les risques iatrogéniques et proposer des alternatives.
Une communication régulière entre tous ces acteurs, autour d’un plan de soins partagé, optimise la prise en charge.
Le traitement médicamenteux : quand et comment ?
Les limites et risques des psychotropes
Bien que cet article se concentre sur les approches non médicamenteuses, il est important d’aborder brièvement la question du traitement médicamenteux de l’agitation, ne serait-ce que pour en souligner les limites et les risques.
Les psychotropes (neuroleptiques, anxiolytiques, antidépresseurs) sont malheureusement encore trop souvent utilisés en première intention face à l’agitation, alors qu’ils devraient être réservés aux situations où les approches non médicamenteuses ont échoué et où l’agitation met en danger la personne ou son entourage.
Les neuroleptiques (antipsychotiques), bien qu’ils puissent réduire l’agitation, comportent des risques importants chez les personnes âgées : risque accru d’AVC, de décès, de sédation excessive, de chutes, de troubles de la déglutition, d’aggravation des troubles cognitifs, d’effets extrapyramidaux (parkinsonisme).
Les benzodiazépines, souvent prescrites pour leur effet anxiolytique, peuvent paradoxalement aggraver l’agitation, particulièrement chez les personnes atteintes de démence. Elles augmentent aussi le risque de chutes, de confusion, et de dépendance.
Les recommandations actuelles de bonne pratique préconisent donc une approche graduée : toujours commencer par rechercher et traiter une cause médicale, puis mettre en place des interventions non médicamenteuses pendant au moins 2 à 4 semaines. Ce n’est qu’en cas d’échec de ces approches et si l’agitation reste sévère et dangereuse qu’un traitement médicamenteux peut être envisagé, à la dose minimale efficace, pour la durée la plus courte possible, avec une réévaluation régulière.
Stratégies de déprescription
Pour les personnes déjà sous traitement psychotrope pour leur agitation, une stratégie de réduction progressive puis d’arrêt (déprescription) doit être envisagée, particulièrement si des approches non médicamenteuses peuvent être mises en place en parallèle.
Cette déprescription doit être progressive, supervisée médicalement, et accompagnée d’une surveillance étroite. Elle réussit dans de nombreux cas et permet d’éviter les effets indésirables des psychotropes sans aggravation de l’agitation, particulièrement si les interventions non médicamenteuses sont optimisées.
Prévention de l’agitation : une approche proactive
Anticiper les situations à risque
La meilleure gestion de l’agitation est sa prévention. Identifier les situations, moments et contextes qui déclenchent typiquement l’agitation permet d’intervenir en amont.
Les soins corporels (toilette, habillage, changement de protections) sont des situations fréquemment génératrices d’agitation. Anticiper en prévenant la personne, en expliquant simplement ce qui va se passer, en respectant son rythme et sa pudeur, en proposant de l’aide sans imposer, en utilisant la distraction, peut prévenir de nombreux épisodes.
Les transitions (passage d’une activité à une autre, changement de lieu) doivent être préparées et accompagnées. Prévenir la personne, lui laisser le temps de s’adapter, ne pas brusquer sont des principes importants.
Les visites médicales peuvent être source d’anxiété. Préparer la personne, si possible visiter les lieux à l’avance, être présent pour rassurer, expliquer ce qui se passe peuvent réduire le stress.
Maintenir la qualité de vie
Au-delà de la gestion de l’agitation, l’objectif fondamental est de maintenir la meilleure qualité de vie possible pour la personne atteinte et pour son entourage.
Cela passe par le respect de la dignité de la personne en toutes circonstances, la reconnaissance de son identité et de son histoire, le maintien de contacts sociaux et affectifs, la proposition d’activités significatives, l’attention portée au confort et au bien-être, et la création d’un environnement de vie chaleureux et sécurisant.
Les programmes comme JOE de DYNSEO peuvent également contribuer à la qualité de vie. Conçu pour les adultes, JOE propose des exercices de stimulation cognitive variés et adaptables qui peuvent être utilisés préventivement pour maintenir les fonctions cognitives et offrir des moments d’engagement positif.
En maintenant une stimulation cognitive régulière et adaptée, en proposant des activités structurées et motivantes, et en créant des routines prévisibles autour de ces moments d’entraînement, on peut contribuer à prévenir l’ennui et la frustration qui sont souvent à l’origine de l’agitation.
Conclusion : L’agitation comme langage à décoder
L’agitation chez la personne âgée, particulièrement dans le contexte des troubles cognitifs, n’est jamais un symptôme isolé sans signification. C’est toujours l’expression d’un besoin, d’un inconfort, d’une souffrance que la personne ne peut plus exprimer autrement. Notre rôle, en tant que professionnels ou aidants familiaux, est d’apprendre à décoder ce langage, à en comprendre le sens, et à y répondre de manière appropriée et bienveillante.
Les approches non médicamenteuses, fondées sur la compréhension des causes, l’adaptation de l’environnement, la modification de nos interactions, et la proposition d’activités adaptées, constituent la pierre angulaire de la gestion de l’agitation. Elles sont efficaces, sans effets indésirables, et respectueuses de la dignité de la personne.
La formation des professionnels et des aidants familiaux est un investissement essentiel pour améliorer la qualité de la prise en charge. Les formations proposées par DYNSEO offrent les connaissances théoriques et les outils pratiques nécessaires pour faire face aux défis de l’agitation au quotidien. Les programmes de stimulation cognitive EDITH et JOE constituent des ressources précieuses pour maintenir l’engagement cognitif et prévenir l’agitation liée à l’ennui ou à la frustration.
Gérer l’agitation demande de la patience, de la créativité, de la compassion, et une volonté constante de chercher à comprendre plutôt qu’à contrôler. Chaque personne est unique, et ce qui fonctionne pour l’une peut ne pas fonctionner pour l’autre. L’observation attentive, l’essai de différentes approches, l’adaptation constante sont les clés du succès.
N’oublions jamais que derrière chaque comportement agité se cache une personne qui souffre et qui a besoin d’aide. Notre réponse à cette souffrance définit la qualité de notre accompagnement et notre humanité.
Ressources et accompagnement DYNSEO
DYNSEO s’engage à vos côtés pour vous accompagner dans la gestion des troubles du comportement incluant l’agitation :
Pour les professionnels de santé
Formation « Troubles du comportement liés à la maladie : méthodes et coordination pluridisciplinaire »
Formation complète pour acquérir les compétences essentielles dans la gestion des troubles du comportement, incluant des stratégies pratiques et fondées sur les preuves.
👉 Accéder à la formation professionnels
Pour les familles et les proches aidants
Formation « Changements de comportement liés à la maladie : guide pratique pour les proches »
Formation spécialement conçue pour aider les familles à comprendre et gérer au quotidien l’agitation et les autres troubles du comportement.
👉 Accéder à la formation familles
Programmes de stimulation cognitive
EDITH – Pour les seniors et les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives
Plus de 30 jeux de mémoire et exercices cognitifs adaptés, avec niveaux de difficulté ajustables et interface intuitive.
JOE – Coach cérébral pour adultes
Programme d’entraînement cérébral pour adultes, pour maintenir et améliorer les fonctions cognitives au quotidien.
—
Mots-clés : agitation personne âgée, troubles du comportement, démence, Alzheimer, interventions non médicamenteuses, gestion agitation, formation aidants, stimulation cognitive, communication adaptée, approches comportementales, DYNSEO





