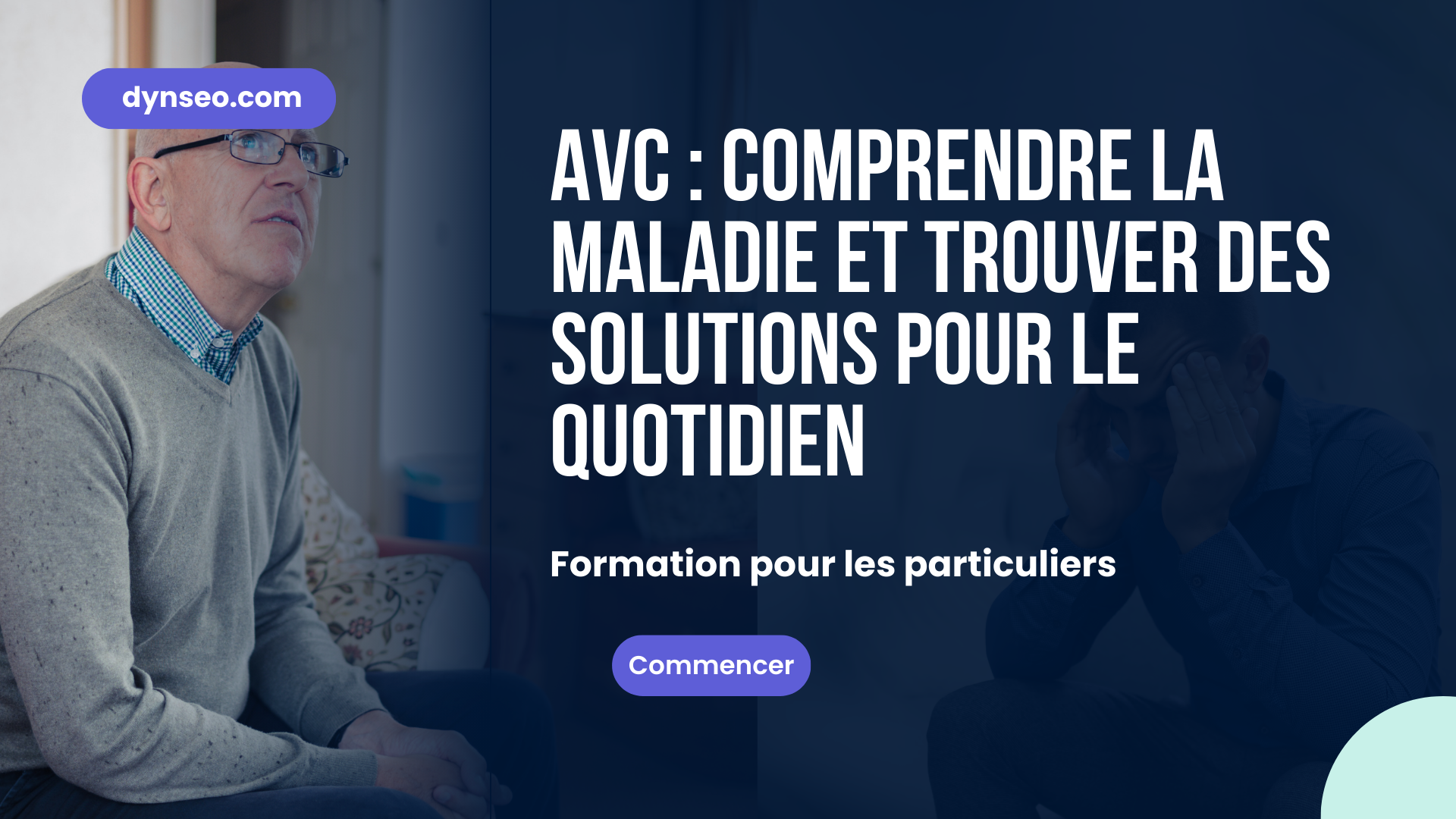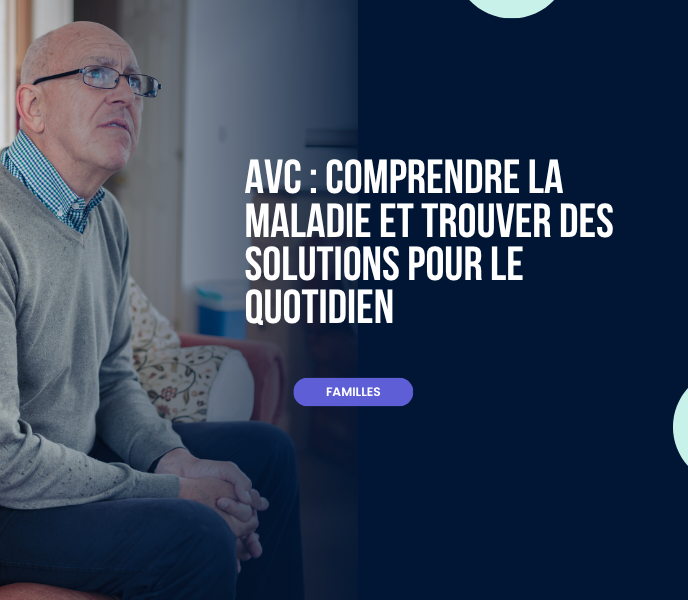Le travail représente bien plus qu’un simple gagne-pain. C’est une source d’identité, de lien social, de valorisation personnelle. Après un AVC, la question du retour au travail devient centrale pour beaucoup de patients en âge actif. Est-ce possible ? Dans combien de temps ? Avec quels aménagements ? Quels sont mes droits ? Dans cet article, nous vous guidons pas à pas dans votre projet de retour au travail, de l’évaluation de vos capacités jusqu’à la reprise effective, en passant par toutes les démarches administratives et les aménagements possibles.
Pourquoi le retour au travail est-il si important ?
Le travail, pilier de l’identité
Pour la plupart des adultes en activité, le travail structure la vie quotidienne et constitue une part importante de l’identité.
Ce que représente le travail :
L’identité professionnelle : “Je suis ingénieur”, “Je suis enseignante”, “Je suis commercial”… Cette identité peut être bouleversée par l’AVC.
Le lien social : Les collègues, les clients, les partenaires… Le travail crée un réseau social souvent essentiel.
Le rythme de vie : Se lever le matin, avoir un objectif, une structure temporelle.
La valorisation : Se sentir utile, compétent, reconnu pour son travail.
L’autonomie financière : Subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
Perdre tout cela brutalement suite à l’AVC peut générer une crise identitaire profonde. Retrouver un emploi (le même ou un autre) devient alors un objectif thérapeutique en soi.
Les bénéfices du retour au travail sur la récupération
Au-delà de l’aspect financier et identitaire, reprendre une activité professionnelle a des effets positifs sur la récupération.
Les bénéfices observés :
Stimulation cognitive : Le travail sollicite votre mémoire, votre attention, vos capacités de résolution de problèmes. Cette stimulation favorise la plasticité cérébrale.
Motivation accrue : Avoir un objectif concret (retourner au travail) booste la motivation pour la rééducation.
Restauration de l’estime de soi : Retrouver un rôle professionnel combat le sentiment d’inutilité.
Routine structurante : Le travail impose un rythme, des horaires, une discipline qui aident à sortir de l’apathie.
Projection dans l’avenir : Reprendre le travail, c’est se projeter à nouveau dans la vie, ne plus être uniquement “un patient”.
Cependant, ces bénéfices ne sont réels que si le retour se fait dans de bonnes conditions. Un retour précipité ou inadapté peut au contraire être délétère.
Les défis spécifiques selon les séquelles
Les séquelles d’un AVC sont variables et influencent fortement les possibilités de reprise.
Séquelles motrices :
Si votre métier nécessite de la force physique, de la coordination fine, ou de la mobilité importante, les séquelles motrices peuvent être un obstacle majeur.
Exemples de métiers impactés : Ouvrier du bâtiment, chirurgien, musicien, chauffeur, artisan…
Séquelles cognitives :
Troubles de la mémoire, de l’attention, de la concentration, ralentissement du traitement de l’information… Ces séquelles invisibles sont souvent sous-estimées mais peuvent être très handicapantes au travail.
Exemples de métiers impactés : Tous les métiers intellectuels, gestion, enseignement, métiers nécessitant multitâches…
Séquelles de communication :
Aphasie, troubles de l’articulation (dysarthrie), difficultés à trouver ses mots…
Exemples de métiers impactés : Commercial, enseignant, accueil, téléprospection, avocat…
Fatigue :
La fatigue post-AVC est souvent sous-estimée mais peut être l’obstacle principal au retour au travail.
Impact : Incapacité à tenir une journée complète, baisse de performance en fin de journée, besoin de repos fréquents.
Évaluer sa capacité à reprendre le travail
L’évaluation médicale
Avant toute démarche de reprise, une évaluation médicale approfondie est indispensable.
Qui consulter ?
Votre médecin du travail : C’est l’interlocuteur clé. Il évalue votre aptitude à reprendre votre poste ou un poste aménagé. Sa visite est obligatoire avant la reprise.
Votre médecin rééducateur : Il connaît vos séquelles et peut évaluer leur impact sur votre activité professionnelle.
Un ergothérapeute : Il peut analyser votre poste de travail et identifier les obstacles et solutions.
Un neuropsychologue : Si vous avez des troubles cognitifs, son évaluation est précieuse pour identifier ce qui est possible ou non dans votre travail.
Ce qui est évalué :
Les capacités physiques : Force, endurance, coordination, équilibre, capacité à maintenir une posture.
Les capacités cognitives : Mémoire, attention, concentration, capacités de planification, gestion du stress.
Les capacités de communication : Expression orale et écrite, compréhension.
La fatigabilité : Tolérance à l’effort, capacité à maintenir une activité sur la durée.
L’autonomie : Dans les déplacements, les gestes du quotidien professionnel.
L’auto-évaluation honnête
Vous êtes le mieux placé pour savoir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Mais l’anosognosie (méconnaissance de ses déficits) peut fausser cette perception.
Questions à vous poser :
Endurance :
- Puis-je rester concentré 2 heures d’affilée ?
- Puis-je tenir une journée de 7-8 heures sans épuisement ?
- À quelle heure de la journée suis-je le plus en forme ?
- Puis-je gérer plusieurs tâches en même temps ?
- Ma mémoire me permet-elle de suivre des dossiers complexes ?
- Suis-je aussi rapide qu’avant dans mon travail ?
- Puis-je m’exprimer clairement à l’oral ?
- Puis-je écrire sans erreurs ?
- Puis-je comprendre des consignes complexes ?
- Puis-je me déplacer facilement sur mon lieu de travail ?
- Puis-je utiliser les transports pour m’y rendre ?
- Me sens-je prêt(e) émotionnellement à reprendre ?
- Suis-je capable de gérer le stress professionnel ?
- Votre mémoire de travail (essentielle pour suivre des dossiers)
- Votre attention soutenue (tenir une réunion, lire un document long)
- Votre attention partagée (gérer plusieurs informations en même temps)
- Votre flexibilité mentale (passer d’une tâche à l’autre)
- Votre vitesse de traitement de l’information
- Reprise progressive qui limite la fatigue
- Maintien du lien avec l’entreprise et les collègues
- Temps disponible pour poursuivre la rééducation
- Transition en douceur vers un retour complet
- Horaires décalés pour éviter les heures de pointe
- Flexibilité pour arriver plus tard si fatigue matinale
- Pauses plus fréquentes
- Journées plus courtes (7h au lieu de 8h par exemple)
- Poste de travail ergonomique adapté
- Logiciels d’assistance (reconnaissance vocale, agrandissement d’écran)
- Outils facilitateurs
- Accessibilité des locaux (rampe, ascenseur, toilettes adaptées)
- Réduction des tâches les plus difficiles
- Répartition différente des missions
- Télétravail partiel ou total
- Modification du contenu du poste
- Un ouvrier du bâtiment avec séquelles motrices peut être reclassé sur un poste administratif
- Un commercial avec troubles de l’élocution peut être reclassé sur un poste de back-office
- Évaluer votre état de santé
- Étudier les aménagements possibles du poste
- Préparer votre retour dans les meilleures conditions
- Éventuellement, recommander un temps partiel thérapeutique
- Vous-même
- Votre médecin traitant
- Le médecin-conseil de la CPAM
- Matinée : exercices cognitifs, lecture, gestion administrative
- Après-midi : activité légère, rééducation, tâches domestiques
- Évaluer votre capacité à prendre les transports ou conduire
- Mesurer votre fatigue à l’arrivée
- Identifier d’éventuels obstacles (escaliers, correspondances)
- Chronométrer la durée réelle
- Informez de votre date de retour
- Expliquez (si vous le souhaitez) vos éventuelles limitations
- Préparez vos collègues à d’éventuels changements (votre élocution, votre mobilité, votre rythme)
- Visualiser positivement votre retour
- Parler de vos craintes avec un psychologue si besoin
- Vous rappeler vos compétences et vos réussites
- Accepter que les premiers jours seront fatigants
- Place de parking réservée proche de l’entrée
- Adaptation du poste (bureau réglable, siège ergonomique)
- Accessibilité des locaux (rampe, ascenseur)
- Télétravail partiel ou total
- Clavier et souris adaptés
- Reconnaissance vocale pour la saisie
- Bureau adapté en hauteur
- Outils à une main
- Bureau isolé ou séparation pour limiter les distractions
- Réduction des interruptions (créneaux sans téléphone/mails)
- Utilisation d’un casque anti-bruit
- Tâches séquencées plutôt que multitâches
- Outils de prise de notes systématiques
- Utilisation d’agendas électroniques avec rappels
- Procédures écrites pour les tâches répétitives
- Enregistrement des réunions (avec accord)
- Réduction de la charge de travail
- Délais allongés pour les tâches
- Moins de pression temporelle
- Travail sur des projets plutôt que de l’urgence
- Privilégier la communication écrite (mails vs téléphone)
- Utilisation d’outils d’aide à la communication
- Temps supplémentaire pour formuler
- Collègues sensibilisés pour ne pas finir vos phrases
- Réduction des tâches nécessitant une communication orale intensive
- Utilisation de la visioconférence avec sous-titres automatiques
- Environnement calme pour les échanges importants
- Journées plus courtes
- Semaine de 4 jours
- Horaires décalés selon votre pic de forme
- Micro-pauses de 5 minutes toutes les heures
- Pause déjeuner allongée pour repos
- Économie de l’énergie du trajet
- Environnement contrôlé
- Possibilité de micro-siestes
- Tâches exigeantes le matin (généralement pic d’énergie)
- Tâches légères l’après-midi
- L’impact des séquelles sur les activités complexes
- Les stratégies de compensation
- La communication avec l’employeur et les collègues
- Les droits et démarches administratives
- Les défis du retour au travail
- Comment soutenir sans pression
- La gestion de l’équilibre vie pro / vie perso
- L’acceptation si le retour n’est pas possible
- Une évaluation honnête et professionnelle de vos capacités
- Une progressivité : ne vous précipitez pas
- Des aménagements adaptés et évolutifs
- Une communication ouverte avec l’employeur et les collègues
- La connaissance de vos droits et le courage de les faire valoir
- L’acceptation de vos limites actuelles sans renoncer à progresser
- Le maintien d’une rééducation parallèle
- Un soutien psychologique si nécessaire
Capacités cognitives :
Communication :
Mobilité :
Émotionnel :
Si vous répondez “non” ou “je ne sais pas” à plusieurs de ces questions, il est probablement trop tôt pour reprendre à plein temps.
Travailler ses capacités cognitives pour optimiser la reprise
Si vos séquelles sont principalement cognitives, vous pouvez travailler activement ces fonctions pour maximiser vos chances de reprise réussie.
JOE, votre coach cérébral, propose un entraînement ciblé des fonctions cognitives essentielles au travail.
Avec JOE, vous pouvez travailler :
En vous entraînant régulièrement, vous améliorez objectivement vos performances et vous obtenez un suivi de vos progrès qui peut être utile lors des évaluations médicales.
Les différentes modalités de reprise
Il n’y a pas qu’un seul scénario de reprise du travail. Plusieurs options existent selon votre état.
Le temps partiel thérapeutique
C’est souvent la modalité de reprise la plus adaptée après un AVC.
Comment ça fonctionne ?
Vous reprenez le travail à temps partiel (par exemple 50% ou 80%) tout en bénéficiant d’une indemnisation par la Sécurité sociale pour compenser la perte de salaire.
Durée maximale : Le temps partiel thérapeutique peut durer jusqu’à 1 an (renouvelable dans certains cas).
Avantages :
Comment l’obtenir ?
1. Votre médecin traitant ou médecin rééducateur prescrit le temps partiel thérapeutique
2. Le médecin-conseil de la CPAM valide la prescription
3. Votre employeur doit être d’accord (sauf cas spécifiques)
4. La durée et le pourcentage de temps de travail sont définis
Rémunération :
Vous touchez votre salaire au prorata du temps travaillé + des indemnités journalières de la Sécurité sociale pour compenser partiellement la perte (environ 50% du salaire brut de base, dans la limite du plafond).
La reprise à temps plein avec aménagements
Si votre état le permet, vous pouvez reprendre à temps plein avec des aménagements de votre poste.
Types d’aménagements possibles :
Aménagements d’horaires :
Aménagements matériels :
Aménagements organisationnels :
Qui finance les aménagements ?
L’employeur : a l’obligation d’aménager le poste dans la mesure du raisonnable.
L’AGEFIPH : peut financer des aménagements conséquents (jusqu’à 10 000€) si vous êtes reconnu travailleur handicapé.
La MDPH : via la PCH (Prestation de Compensation du Handicap) pour certaines aides techniques.
Le FIPHFP : pour les agents de la fonction publique.
Le reclassement professionnel
Si votre poste initial n’est plus compatible avec vos séquelles, un reclassement est envisageable.
Le reclassement interne :
Votre employeur doit chercher à vous proposer un autre poste dans l’entreprise, compatible avec vos capacités actuelles.
Exemples :
L’employeur a l’obligation de rechercher sérieusement ces possibilités avant d’envisager un licenciement pour inaptitude.
Le reclassement externe (reconversion) :
Si le reclassement interne n’est pas possible, vous pouvez envisager une reconversion professionnelle vers un nouveau métier.
Les aides à la reconversion :
Le CPF (Compte Personnel de Formation) : Vous pouvez utiliser vos droits pour financer une formation.
Le CPF de transition professionnelle : Pour les reconversions longues nécessitant une formation qualifiante.
L’AGEFIPH : Aide au financement de formations pour les travailleurs handicapés.
Pôle Emploi : Accompagnement et financement possible de formations.
Cap Emploi : Organisme spécialisé dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Ils peuvent vous accompagner dans votre projet.
L’arrêt définitif et la retraite anticipée
Pour certains patients, le retour au travail n’est malheureusement pas possible.
La mise en invalidité :
Si vos séquelles vous empêchent durablement de travailler, vous pouvez être mis en invalidité (catégorie 1, 2 ou 3 selon le degré).
Catégorie 1 : Vous pouvez travailler mais votre capacité est réduite d’au moins 2/3. Pension = 30% du salaire annuel moyen.
Catégorie 2 : Vous ne pouvez plus exercer d’activité professionnelle. Pension = 50% du salaire annuel moyen.
Catégorie 3 : Impossibilité de travailler + nécessité d’une assistance d’une tierce personne. Pension majorée.
La retraite pour invalidité :
Si vous êtes en invalidité catégorie 2 et que vous atteignez l’âge légal de départ à la retraite, votre pension d’invalidité se transforme automatiquement en pension de retraite au taux plein, sans condition de durée de cotisation.
La retraite anticipée pour handicap :
Si vous êtes reconnu travailleur handicapé et que vous remplissez certaines conditions de durée de cotisation, vous pouvez partir à la retraite avant l’âge légal.
Vos droits et les démarches administratives
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
C’est une démarche volontaire mais fortement recommandée après un AVC avec séquelles.
Pourquoi demander la RQTH ?
Protection contre le licenciement : Procédure de licenciement plus encadrée, délais de préavis doublés.
Obligation d’aménagement : L’employeur a une obligation renforcée d’aménager votre poste.
Accès à des aides : Financements pour aménagements, formations, accompagnement par Cap Emploi.
Priorité de maintien dans l’emploi : En cas de licenciement économique.
Quotas d’emploi : Les entreprises de plus de 20 salariés doivent employer 6% de travailleurs handicapés. Votre RQTH les aide à remplir cette obligation, ce qui peut faciliter votre maintien ou votre embauche.
Comment l’obtenir ?
1. Constituez un dossier MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
2. Joignez un certificat médical détaillant vos séquelles
3. La CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie) étudie votre dossier
4. Décision sous 3 à 6 mois généralement
Durée : La RQTH est généralement accordée pour 1 à 5 ans, renouvelable.
Important : La RQTH est confidentielle. Vous n’êtes pas obligé d’en informer votre employeur, mais c’est fortement recommandé pour bénéficier des aménagements.
La visite de pré-reprise et la visite de reprise
La visite de pré-reprise (facultative mais recommandée) :
Pendant votre arrêt de travail (au moins 30 jours avant la reprise prévue), vous pouvez demander une visite de pré-reprise avec le médecin du travail.
Objectifs :
Qui peut la demander ?
La visite de reprise (obligatoire) :
Dans les 8 jours suivant votre reprise effective, vous devez obligatoirement voir le médecin du travail.
Le médecin rend un avis :
Apte : Vous pouvez reprendre votre poste sans restriction.
Apte avec réserves ou aménagements : Vous pouvez reprendre avec des conditions précises (horaires, tâches limitées, aménagements matériels).
Inapte : Vous ne pouvez pas reprendre votre poste actuel. L’employeur doit alors chercher un reclassement. Si aucun reclassement n’est possible, un licenciement pour inaptitude peut être prononcé (avec indemnités spécifiques).
Contestation : Si vous n’êtes pas d’accord avec l’avis du médecin du travail, vous pouvez saisir le conseil des prud’hommes.
Les obligations de l’employeur
Votre employeur a des obligations légales en matière de maintien dans l’emploi.
Obligation d’aménagement raisonnable du poste :
L’employeur doit prendre les mesures appropriées pour vous permettre de travailler, sauf si ces mesures représentent une charge disproportionnée.
Recherche de reclassement :
En cas d’inaptitude à votre poste, l’employeur doit rechercher activement un autre poste compatible dans l’entreprise (ou le groupe).
Interdiction de discrimination :
L’employeur ne peut pas vous discriminer en raison de votre état de santé ou de votre handicap (salaire, promotion, formation, licenciement).
Entretien de liaison (recommandé) :
Pendant votre arrêt long, l’employeur peut organiser des entretiens de liaison pour maintenir le lien et préparer votre retour. Ces entretiens sont facultatifs et nécessitent votre accord.
Préparer son retour concrètement
Les semaines avant la reprise
Reprendre un rythme progressivement :
Si vous avez été en arrêt plusieurs mois, votre rythme de vie s’est ralenti. Commencez à vous lever plus tôt, à structurer vos journées.
Simuler des journées de travail :
Essayez de rester actif et concentré pendant 7-8h (avec pauses). Par exemple :
Cela vous permet de tester votre endurance et d’identifier vos limites.
Tester le trajet domicile-travail :
Faites le trajet plusieurs fois pour :
Communiquer avec votre employeur et vos collègues :
Avant la reprise, prenez contact :
Préparer psychologiquement :
Anticiper le retour peut générer du stress. C’est normal.
Stratégies :
Le jour J et les premières semaines
Le premier jour :
Arrivez reposé(e) : Couchez-vous tôt la veille, ne planifiez rien de fatigant avant.
Prévenez votre hiérarchie de vos besoins : “J’aurai besoin de pauses régulières”, “Je ne pourrai pas assister à des réunions après 16h dans un premier temps”.
Soyez indulgent(e) avec vous-même : Vous ne serez pas à 100% de vos capacités d’avant. C’est normal et acceptable.
Les premières semaines :
Écoutez votre corps : Si la fatigue est trop intense, parlez-en rapidement à votre médecin du travail. Il vaut mieux ajuster rapidement que s’épuiser.
Notez vos difficultés : Tenez un journal de vos journées. Qu’est-ce qui a été difficile ? À quel moment ? Cela permettra d’identifier les aménagements nécessaires.
Communiquez : Si une tâche est trop difficile, dites-le. Ne vous obstinez pas dans une tâche impossible, cherchez une alternative.
Célébrez vos réussites : Vous avez tenu une journée complète ? Vous avez géré un dossier complexe ? C’est une victoire !
Maintenez votre rééducation : Si vous avez encore des séances, ne les sacrifiez pas sur l’autel du travail. Elles restent importantes.
Les aménagements pratiques possibles
Pour les troubles moteurs
Si vous avez des difficultés de déplacement :
Si vous avez une hémiparésie :
Pour les troubles cognitifs
Si vous avez des troubles de l’attention :
Si vous avez des troubles de la mémoire :
Si vous avez un ralentissement :
Pour les troubles de communication
Si vous avez une aphasie ou des troubles du langage :
Si vous avez une dysarthrie (troubles de l’articulation) :
Pour la gestion de la fatigue
La fatigue est souvent le défi majeur. Aménagements possibles :
Horaires adaptés :
Pauses fréquentes :
Télétravail :
Répartition des tâches :
Se former pour mieux comprendre et agir
Comprendre les impacts de l’AVC sur le travail
Plus vous comprenez vos séquelles et leurs impacts fonctionnels, mieux vous pouvez expliquer vos besoins et négocier des aménagements.
DYNSEO propose une formation complète sur l’AVC qui vous aide à faire ces liens entre séquelles et vie quotidienne, y compris professionnelle.
Cette formation aborde :
Un guide pour impliquer les proches
Vos proches peuvent jouer un rôle dans votre retour au travail : soutien moral, aide logistique, discussions sur vos choix…
Le guide pour accompagner les personnes suite à un AVC les aide à comprendre vos enjeux professionnels.
Ce guide aborde :
Témoignages de retours réussis
Sophie, 42 ans, cadre administrative
“J’ai fait un AVC à 42 ans. Séquelles cognitives : fatigue, troubles de l’attention. Au début, je pensais que je ne pourrais jamais reprendre mon poste de responsable RH. J’ai commencé par un temps partiel thérapeutique à 50%, télétravail 3 jours par semaine. J’ai utilisé JOE tous les jours pour retravailler ma concentration. Au bout de 6 mois, je suis passée à 80%. Aujourd’hui, un an après, je suis revenue à temps plein. J’ai gardé 2 jours de télétravail, et je délègue plus qu’avant. Mais je travaille. Je suis fière de moi.”
Marc, 55 ans, technicien de maintenance
“Mon AVC m’a laissé une hémiparésie droite modérée. Mon métier nécessitait beaucoup de force et de dextérité manuelle. Impossible de continuer. Mon employeur m’a proposé un reclassement en planification/ordonnancement. J’ai suivi une formation de 3 mois financée par l’AGEFIPH. Je suis maintenant sur un poste administratif dans le même service. Ce n’est pas le métier que j’avais choisi, mais j’ai gardé mon emploi et mes collègues. Je me suis adapté.”
Claire, 38 ans, enseignante
“AVC avec aphasie. Au début, je ne pouvais presque pas parler. Après 6 mois de rééducation intensive, j’ai récupéré environ 80%. J’avais peur de ne plus pouvoir enseigner. Mon chef d’établissement a été formidable. J’ai repris à mi-temps sur des niveaux que je connaissais bien (moins de préparation nécessaire). Les élèves ont été prévenus et se sont montrés patients. Deux ans après, je suis revenue à temps plein. Je parle moins vite qu’avant, je cherche parfois mes mots, mais ça fonctionne.”
Quand le retour au travail n’est pas possible
Accepter et se reconstruire autrement
Pour certains patients, les séquelles sont trop importantes pour envisager un retour au travail.
C’est une réalité difficile mais qui n’est pas une fin en soi.
Le processus d’acceptation :
Comme pour toute perte, il y a un deuil à faire : le deuil de son identité professionnelle, de ses projets de carrière, de ses rêves.
Ce deuil passe par plusieurs phases : déni, colère, négociation, tristesse, acceptation. Prenez le temps de traverser ces émotions. Un psychologue peut vous accompagner.
Trouver d’autres sources d’épanouissement
Le travail n’est pas la seule source d’identité et de valorisation.
Autres voies d’épanouissement :
Le bénévolat : S’engager dans une association permet de se sentir utile, de créer du lien social, d’avoir des objectifs.
Les loisirs créatifs : Peinture, écriture, musique, jardinage… Développer un talent créatif peut devenir une nouvelle identité.
La formation pour le plaisir : Apprendre une langue, l’histoire de l’art, l’astronomie… Stimuler son intellect sans pression professionnelle.
Le rôle familial investi : Certains trouvent un nouvel équilibre en investissant davantage leur rôle de parent, grand-parent, aidant.
L’activité physique adaptée : Le sport adapté crée du lien, des défis personnels, de la fierté.
Conclusion : Le retour au travail, un projet personnalisé
Il n’y a pas un scénario unique de retour au travail après un AVC. Chaque situation est unique, fonction de vos séquelles, de votre métier, de votre employeur, de vos aspirations.
Les clés d’un retour réussi :
Que vous repreniez votre poste initial, que vous vous reconvertissiez, ou que vous choisissiez une autre voie, l’important est de trouver un équilibre qui respecte vos capacités actuelles tout en nourrissant votre besoin d’utilité et d’identité.
Les ressources existent pour vous accompagner : la formation DYNSEO pour comprendre vos défis, le programme JOE pour entraîner vos capacités cognitives, le guide d’accompagnement pour impliquer vos proches.
Votre identité ne se résume pas à votre travail. Mais si le travail compte pour vous, battez-vous pour y retourner dans de bonnes conditions. Et si ce n’est pas possible, sachez qu’une vie riche et épanouie existe aussi en dehors du monde professionnel.
Bonne reprise, quelle que soit la forme qu’elle prendra.