Les troubles du sommeil représentent l’un des défis les plus épuisants dans l’accompagnement des personnes atteintes de troubles cognitifs. Lorsque les nuits deviennent des périodes d’agitation, de déambulation, de cris ou de confusion, c’est toute la maisonnée qui en souffre. Les aidants, privés de leur propre sommeil nuit après nuit, s’épuisent rapidement, leur santé se dégrade, et le risque de burn-out augmente considérablement. Les études montrent que les troubles du sommeil de la personne aidée constituent l’un des facteurs prédictifs les plus puissants de la décision d’institutionnalisation.
Ces troubles ne sont pas une fatalité. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le vieillissement normal n’entraîne pas nécessairement d’insomnie sévère ou d’inversion du rythme veille-sommeil. Ces perturbations sont liées aux pathologies neurodégénératives et à leurs conséquences sur les mécanismes de régulation du sommeil. Elles ont des causes identifiables et peuvent être améliorées, souvent de façon significative, par des approches non médicamenteuses structurées autour de protocoles jour/nuit cohérents.
Cet article explore en profondeur les mécanismes des troubles du sommeil dans les démences, détaille les protocoles jour/nuit efficaces pour restaurer un rythme circadien plus régulier, et propose des stratégies concrètes pour gérer les perturbations nocturnes. Car des nuits plus paisibles sont possibles, et elles sont essentielles à la qualité de vie de tous.
Comprendre les troubles du sommeil dans les démences
Les mécanismes du sommeil et leur altération
Le sommeil est un processus complexe régulé par deux systèmes principaux : l’horloge circadienne et la pression homéostatique du sommeil.
L’horloge circadienne est notre rythme biologique interne d’environ 24 heures, régulé principalement par la lumière. Elle dicte les moments de veille et de sommeil, mais aussi de nombreuses autres fonctions physiologiques (température corporelle, sécrétion hormonale, pression artérielle). Dans les démences, particulièrement dans la maladie d’Alzheimer, les neurones du noyau suprachiasmatique (siège de l’horloge biologique) dégénèrent, entraînant une désynchronisation progressive du rythme circadien.
La pression homéostatique du sommeil s’accumule au fur et à mesure que nous restons éveillés et se dissipe pendant le sommeil. Les pathologies neurodégénératives perturbent également ce mécanisme, diminuant la capacité à consolider le sommeil.
Les altérations structurelles du sommeil sont fréquentes : diminution du sommeil profond (stade 3-4), fragmentation du sommeil avec de multiples réveils, augmentation du temps d’endormissement, réveil précoce. La qualité du sommeil se détériore avant même que sa quantité ne diminue.
La mélatonine, hormone régulatrice du sommeil sécrétée en réponse à l’obscurité, voit sa production diminuer avec le vieillissement et peut être encore plus perturbée dans les démences.
Types de troubles du sommeil
Les troubles du sommeil dans les démences prennent plusieurs formes, souvent combinées chez une même personne.
L’insomnie d’endormissement se manifeste par une difficulté à s’endormir le soir. La personne reste éveillée pendant de longues périodes après s’être couchée, tournant dans son lit, se levant et se recouchant, manifestant de l’agitation.
Les réveils nocturnes multiples fragmentent le sommeil. La personne se réveille plusieurs fois dans la nuit, parfois pour quelques minutes, parfois pour des heures. Ces réveils peuvent être accompagnés de confusion, d’agitation, de déambulation, de tentatives de sortie.
Le réveil précoce (réveil terminal) fait que la personne se réveille très tôt le matin (3h, 4h, 5h) et ne peut se rendormir, restant éveillée alors qu’il fait encore nuit.
L’inversion du rythme veille-sommeil représente la forme la plus problématique. La personne dort principalement le jour et reste éveillée la nuit. Elle peut dormir par périodes tout au long de la journée puis être parfaitement éveillée et active la nuit.
L’agitation nocturne ou syndrome du coucher de soleil (sundowning) se caractérise par une augmentation de l’agitation, de la confusion et parfois de l’agressivité en fin d’après-midi et soirée. Bien que ce ne soit pas strictement un trouble du sommeil, il rend l’endormissement très difficile.
Les troubles du comportement en sommeil paradoxal sont plus rares mais potentiellement dangereux. La personne met en actes ses rêves, pouvant se blesser ou blesser son partenaire.
L’apnée du sommeil, fréquente chez les personnes âgées, fragmente le sommeil et génère de la fatigue diurne, aggravant les troubles cognitifs.
Conséquences multiples
Les troubles du sommeil ont des répercussions en cascade sur la santé et le bien-être.
Sur la personne atteinte : aggravation des troubles cognitifs (la privation de sommeil altère mémoire, attention, fonctions exécutives), augmentation de l’agitation et de l’irritabilité diurnes, risque accru de chutes nocturnes, affaiblissement du système immunitaire, aggravation des comorbidités (HTA, diabète, maladies cardiovasculaires), diminution de la qualité de vie.
Sur les aidants : privation chronique de sommeil entraînant épuisement, troubles de l’humeur (irritabilité, anxiété, dépression), diminution des capacités cognitives et de vigilance, augmentation des erreurs et accidents, détérioration de leur propre santé, augmentation du risque de burn-out, tension dans la relation avec la personne aidée, et souvent, décision d’institutionnalisation.
Sur la vie familiale : les troubles nocturnes d’un membre de la famille perturbent le sommeil de tous, créent des tensions, limitent la vie sociale (impossibilité d’inviter, de sortir le soir).
Causes des troubles du sommeil
Les troubles du sommeil dans les démences sont multifactoriels, résultant de l’interaction de nombreux facteurs.
Les facteurs neurologiques : dégénérescence des structures cérébrales régulant le sommeil, perturbation des neurotransmetteurs impliqués dans le cycle veille-sommeil, altération de la production de mélatonine.
Les facteurs comportementaux : manque d’activité physique et de stimulation diurnes, siestes excessives en journée, exposition insuffisante à la lumière naturelle, absence de routine régulière de coucher.
Les facteurs environnementaux : chambre inadaptée (trop chaude, trop froide, bruyante, lumineuse), lit inconfortable, environnement non familier (après déménagement, hospitalisation).
Les facteurs médicaux : douleur non traitée, problèmes urinaires (nycturie, incontinence), reflux gastro-œsophagien, apnée du sommeil, syndrome des jambes sans repos, constipation, infections.
Les facteurs médicamenteux : certains médicaments perturbent le sommeil (corticoïdes, certains antihypertenseurs, diurétiques pris le soir, stimulants), tandis que les somnifères peuvent créer une dépendance et un effet paradoxal.
Les facteurs psychologiques : anxiété, dépression, peurs nocturnes, cauchemars liés à la confusion.
Le protocole jour : préparer des nuits paisibles dès le matin
Principe fondamental : renforcer le rythme circadien
L’approche la plus efficace pour améliorer le sommeil nocturne commence dès le réveil. Tout au long de la journée, chaque action doit contribuer à renforcer le signal « jour » au cerveau, créant une pression de sommeil suffisante pour la nuit et synchronisant l’horloge biologique.
L’exposition à la lumière vive
La lumière est le synchroniseur le plus puissant de notre horloge biologique. Son utilisation stratégique est la pierre angulaire du protocole jour.
Au réveil : ouvrir immédiatement les volets et les rideaux pour exposer la personne à la lumière naturelle. Si le réveil est très tôt en hiver et qu’il fait encore nuit, utiliser un éclairage vif artificiel (lampe de luminothérapie 10 000 lux si possible).
Exposition matinale prolongée : passer du temps près des fenêtres, idéalement sortir à l’extérieur pendant au moins 30 minutes le matin (promenade, jardinage, simplement s’asseoir au soleil). L’exposition à la lumière naturelle, même par temps couvert, est beaucoup plus intense que l’éclairage intérieur.
Maintien d’une luminosité élevée en journée : garder l’intérieur bien éclairé toute la journée, ouvrir les stores, utiliser un éclairage d’appoint si nécessaire. Éviter les pièces sombres.
Diminution progressive en fin d’après-midi : à partir de 17h-18h, commencer à baisser progressivement l’intensité lumineuse pour signaler au corps que la nuit approche.
Lampes de luminothérapie : pour les personnes qui sortent peu ou en hiver, une séance de luminothérapie le matin (30 minutes à 10 000 lux) peut être très efficace. Installer la lampe légèrement en hauteur et sur le côté, pas directement face aux yeux.
L’activité physique
L’exercice physique favorise un sommeil de meilleure qualité en augmentant la pression homéostatique du sommeil et en réduisant l’anxiété.
Activité matinale ou en début d’après-midi : privilégier les activités physiques le matin ou en début d’après-midi, pas en fin de journée (l’exercice tardif peut être stimulant et retarder l’endormissement).
Adaptation au niveau : promenade quotidienne (même courte, 15-20 minutes suffisent), gymnastique douce, exercices assis pour ceux qui ont des troubles de la marche, jardinage, danse adaptée, natation douce si accessible.
Régularité : mieux vaut une activité légère quotidienne qu’une activité intense occasionnelle.
Éviter l’épuisement : une fatigue excessive peut paradoxalement nuire au sommeil. Trouver le juste équilibre entre activité suffisante et repos approprié.
La stimulation cognitive et sociale
Un cerveau actif en journée dort mieux la nuit. Les activités cognitives et sociales contribuent à maintenir la veille et à augmenter la pression de sommeil.
Activités cognitives structurées : les programmes de stimulation cognitive comme EDITH de DYNSEO s’intègrent parfaitement dans le protocole jour. Des séances régulières (matin et début d’après-midi) maintiennent l’éveil et l’engagement.
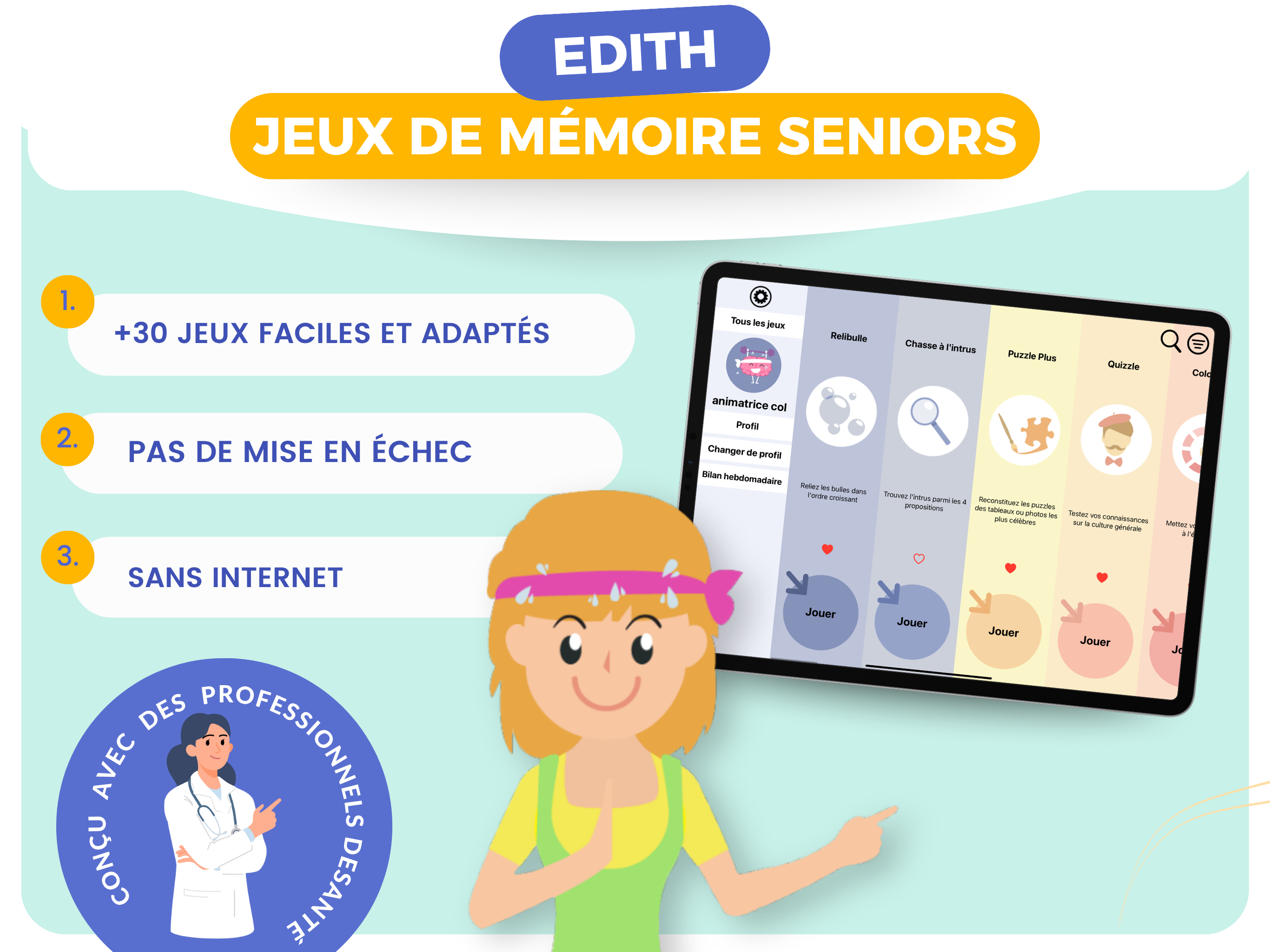
EDITH propose plus de 30 jeux adaptés qui peuvent être utilisés en séances de 15-20 minutes, plusieurs fois dans la journée. L’avantage est que ces activités maintiennent l’éveil sans être épuisantes, et créent des moments de routine structurants.
Pour les adultes plus jeunes, JOE offre une alternative adaptée avec des exercices variés et stimulants.

Interactions sociales : conversations, visites (plutôt en journée qu’en soirée), appels téléphoniques, participation à des groupes ou activités collectives maintiennent l’éveil social.
Activités manuelles : cuisine, artisanat, jardinage, rangement, pliage du linge occupent et stimulent.
Éviter la sous-stimulation : une journée vide, monotone, sans activités mène à l’ennui et aux siestes excessives qui perturbent le sommeil nocturne.
La gestion des siestes
Les siestes sont un sujet délicat. Elles peuvent être bénéfiques si bien gérées, mais problématiques si excessives.
Limiter la durée : pas plus de 20-30 minutes de sieste, idéalement vers 14h-15h. Une sieste courte rafraîchit sans perturber le sommeil nocturne.
Éviter les siestes tardives : pas de sieste après 16h, sinon le sommeil nocturne sera retardé ou écourté.
Réveiller en douceur si la sieste se prolonge : utiliser la lumière, ouvrir les volets, parler doucement, proposer une boisson ou une activité plutôt que de laisser dormir indéfiniment.
Lutter contre la somnolence diurne excessive : si la personne somnole constamment en journée, augmenter l’activité, l’exposition à la lumière, vérifier s’il n’y a pas d’apnée du sommeil non traitée ou d’effets secondaires médicamenteux.
Les repas et l’hydratation
L’alimentation influence le sommeil à plusieurs niveaux.
Des repas réguliers à heures fixes renforcent le rythme circadien. Le corps apprend à anticiper les repas et synchronise d’autres fonctions en conséquence.
Un petit-déjeuner copieux et un déjeuner normal donnent de l’énergie pour la journée.
Un dîner léger et précoce (18h-19h maximum) est digéré avant le coucher et évite les inconforts gastriques nocturnes.
Limiter les excitants : pas de café, thé, cola après 15h-16h. Privilégier les tisanes sans théine.
L’alcool : bien qu’il puisse faciliter l’endormissement, l’alcool fragmente le sommeil en deuxième partie de nuit. À éviter le soir.
L’hydratation : boire suffisamment en journée mais réduire les apports liquidiens après 18h pour limiter les levers nocturnes pour uriner.
Les aliments favorisant le sommeil : les aliments riches en tryptophane (précurseur de la sérotonine et de la mélatonine) comme les produits laitiers, les bananes, les noix peuvent être proposés en soirée.
La routine diurne structurée
La prévisibilité rassure et renforce le rythme biologique.
Des horaires réguliers : lever à heure fixe (même le week-end), repas aux mêmes heures, activités à des moments prévisibles, coucher à heure régulière.
Un planning visible : un tableau ou calendrier avec les activités de la journée aide la personne (si ses capacités le permettent) à se situer dans le temps.
Des transitions douces : annoncer les changements d’activité à l’avance, ne pas brusquer les transitions.
Des rituels diurnes : café du matin à un moment précis, promenade après le déjeuner, jeux en milieu d’après-midi créent des repères temporels.
Le protocole soirée : préparer au sommeil
La transition vers le calme
À partir de 18h environ, l’objectif est de signaler progressivement au corps que la nuit approche.
Diminution de la stimulation : réduire progressivement les activités stimulantes, préférer des activités calmes (musique douce, regarder des photos, conversation tranquille).
Baisse de la luminosité : tamiser les lumières, fermer les volets/rideaux pour signaler l’obscurité extérieure, éviter les écrans (TV, tablette, smartphone) dont la lumière bleue inhibe la production de mélatonine.
Environnement calme : réduire le bruit, parler doucement, éviter les visites excitantes ou les discussions animées.
Activités relaxantes : lecture à voix haute, musique apaisante, massage doux des mains ou des pieds, respiration calme.
Le rituel du coucher
Un rituel prévisible et relaxant conditionne le corps au sommeil.
À heure fixe : commencer le rituel chaque soir à la même heure (par exemple 20h30 pour un coucher à 21h).
Séquence immuable : par exemple : toilette du soir, habillage du pyjama, tisane, brossage des dents, installer dans le lit, massage des mains, musique douce, lumière éteinte. La séquence elle-même devient un signal de sommeil.
Durée appropriée : ni trop longue (fatigue excessive), ni trop courte (pas le temps de se préparer psychologiquement). 20-30 minutes est souvent adéquat.
Pas de précipitation : le coucher ne doit pas être vécu comme une contrainte brusque mais comme une transition douce et agréable.
L’optimisation de l’environnement de sommeil
La chambre doit être un sanctuaire du sommeil.
Température : 18-19°C est idéal pour dormir. Trop chaud ou trop froid perturbe le sommeil.
Obscurité : utiliser des rideaux occultants ou des stores. L’obscurité stimule la production de mélatonine. Si la personne a peur du noir complet, une veilleuse très faible (lumière rouge ou orange plutôt que bleue).
Silence : isoler des bruits extérieurs autant que possible. Si bruits inévitables (rue passante), utiliser des bouchons d’oreille ou un bruit blanc (ventilateur, machine à bruit blanc).
Confort : matelas et oreiller adaptés, literie propre et confortable, nombre de couvertures approprié à la température.
Sécurité : pour les personnes qui se lèvent la nuit, sécuriser l’environnement (veilleuse pour le trajet vers les toilettes, chaussons antidérapants à portée, barres d’appui si nécessaire).
Association lit = sommeil : utiliser le lit uniquement pour dormir (pas pour regarder la TV, manger, etc.) renforce le conditionnement psychologique.
Gestion des perturbations nocturnes
Face aux réveils nocturnes
Lorsque la personne se réveille la nuit, la réaction de l’aidant est cruciale.
Rester calme : ne pas montrer d’énervement, de frustration, ou d’anxiété. Parler doucement, rassurer.
Vérifier les besoins physiologiques : a-t-elle besoin d’aller aux toilettes (cause la plus fréquente) ? A-t-elle soif ? Trop chaud/froid ? Inconfort/douleur ?
Orienter temporellement : « Il est 3h du matin, c’est encore la nuit, il faut dormir » avec une horloge visible.
Réorienter spatialement : « Tu es dans ta chambre, dans ton lit, tu es en sécurité ».
Éviter la sur-stimulation : garder les lumières basses, parler peu et doucement, ne pas engager de conversation prolongée, ne pas proposer d’activité stimulante.
Raccompagner au lit : après avoir satisfait les besoins (toilettes, verre d’eau), raccompagner doucement au lit, border, rassurer, éventuellement rester quelques minutes à proximité.
Techniques de relaxation : respiration calme, massage doux, musique très douce peuvent aider au rendormissement.
Si le rendormissement est impossible : parfois, mieux vaut accepter que la personne se lève un moment (sous surveillance) dans un environnement calme et peu stimulant, plutôt que de lutter et créer de l’agitation. Après 20-30 minutes, proposer à nouveau de retourner au lit.
Face à l’agitation nocturne
L’agitation nocturne nécessite une approche spécifique.
Ne pas contraindre : tenter de forcer la personne à rester au lit aggrave l’agitation. Permettre de se lever tout en assurant la sécurité.
Accompagner plutôt que bloquer : « Tu as besoin de marcher ? Viens, on marche ensemble un peu » permet de surveiller et de contrôler.
Valider les émotions : « Je vois que tu es inquiet, je comprends » sans forcément valider le contenu confus (« je dois aller travailler » alors qu’il est 2h du matin).
Rediriger doucement : après quelques minutes, proposer une alternative : « On a bien marché, maintenant on va se reposer un peu ».
Environnement sécurisé : si la personne déambule la nuit, assurer que l’environnement est sûr (pas d’obstacles, veilleuses, portes extérieures sécurisées).
Face à la confusion nocturne
La confusion est particulièrement marquée la nuit.
Orientation simple : horloge bien visible avec indication jour/nuit, calendrier, rappels simples.
Ne pas argumenter : si la personne est convaincue qu’il est l’heure de se lever pour aller travailler, argumenter longuement est inutile. Valider et rediriger.
Rassurer sur la sécurité : la peur est souvent sous-jacente à la confusion nocturne. Rassurer constamment.
Lumière douce : si allumer une lumière est nécessaire, qu’elle soit douce et chaude, pas vive et blanche qui stimulerait trop.
Approches médicamenteuses : avec prudence
Les limites des somnifères classiques
Les benzodiazépines et apparentés (zopiclone, zolpidem) sont encore trop prescrits malgré leurs risques importants chez les personnes âgées.
Les risques : augmentation du risque de chutes, de confusion, d’aggravation des troubles cognitifs, de dépendance, d’effet paradoxal (excitation au lieu de sédation), d’effet rémanent le lendemain (somnolence diurne).
Les recommandations : éviter leur utilisation chronique, n’envisager qu’en dernier recours après échec des mesures non médicamenteuses, à la dose minimale, pour la durée la plus courte possible.
La mélatonine
La mélatonine à libération prolongée peut être utile, particulièrement chez les personnes dont le rythme circadien est perturbé.
Avantages : naturelle, peu d’effets secondaires, peut aider à resynchroniser le rythme.
Utilisation : dose faible (2mg), prise 1-2h avant le coucher souhaité, régulièrement pendant plusieurs semaines pour évaluer l’efficacité.
Limites : efficacité variable selon les personnes, pas un somnifère puissant mais un régulateur.
Autres options
Les antidépresseurs sédatifs (mirtazapine, trazodone) peuvent être envisagés si dépression associée.
La révision des traitements actuels : éliminer ou ajuster les médicaments qui perturbent le sommeil.
Le traitement des causes médicales : douleur, apnée du sommeil, reflux, etc.
Formation et soutien aux aidants
Gérer sa propre privation de sommeil
Les aidants doivent préserver leur propre sommeil pour tenir sur la durée.
Alternance : si possible, alterner les nuits de surveillance entre plusieurs aidants (conjoint/enfants, professionnels de nuit).
Chambre séparée : si les perturbations nocturnes sont constantes, envisager temporairement des chambres séparées avec un babyphone ou système d’alerte.
Récupération diurne : si les nuits sont très perturbées, l’aidant doit pouvoir récupérer en journée (sieste, aide professionnelle pour pouvoir se reposer).
Aide professionnelle nocturne : garde de nuit, même quelques nuits par semaine, peut sauver l’aidant de l’épuisement.
Accepter l’hébergement temporaire : quelques jours d’hébergement temporaire en établissement permettent à l’aidant de récupérer.
Se former pour mieux gérer
Pour les professionnels de santé, DYNSEO propose la formation « Troubles du comportement liés à la maladie : méthodes et coordination pluridisciplinaire » qui inclut des modules sur la gestion des troubles du sommeil et de l’agitation nocturne.
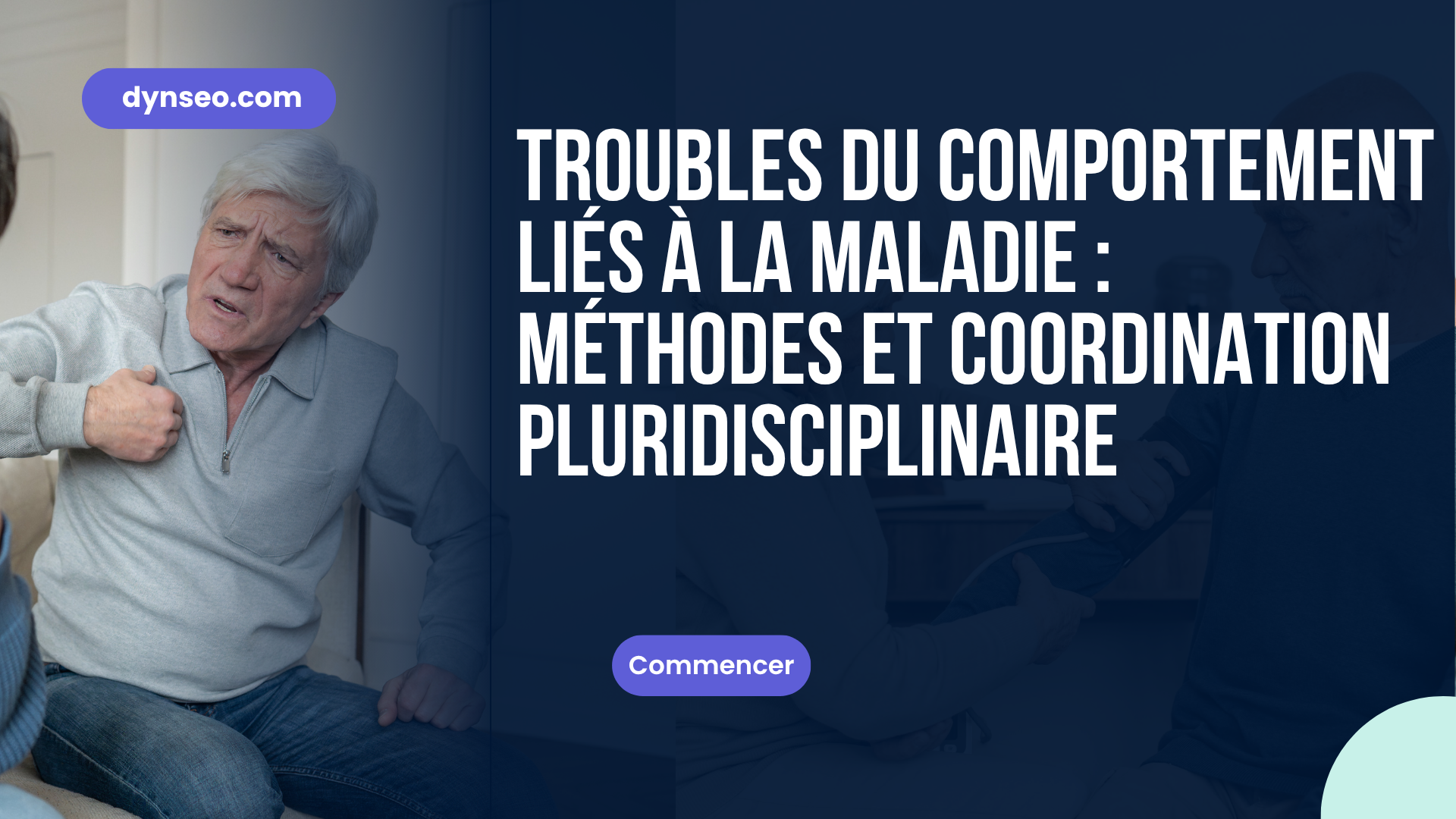
Cette formation enseigne les protocoles jour/nuit, les techniques de gestion des réveils nocturnes, et l’accompagnement des familles face à ces difficultés.
Pour les familles et les proches aidants, DYNSEO a développé la formation « Changements de comportement liés à la maladie : guide pratique pour les proches » avec des modules pratiques sur les troubles du sommeil.

Cette formation aborde les questions concrètes : comment établir un protocole jour/nuit ? Que faire lors des réveils nocturnes ? Comment préserver mon propre sommeil ? Elle offre des outils pratiques immédiatement applicables.
Conclusion : La patience et la constance sont clés
Les troubles du sommeil dans les démences sont l’un des aspects les plus épuisants de l’accompagnement, mais ils ne sont pas une fatalité. L’approche par protocoles jour/nuit structurés, centrée sur le renforcement du rythme circadien et la gestion appropriée des perturbations, apporte des améliorations significatives dans la majorité des cas.
Cette approche demande de la constance et de la patience. Les bénéfices ne sont pas immédiats mais progressifs, apparaissant généralement après 2 à 4 semaines de protocole rigoureux. Il est crucial de ne pas abandonner prématurément si les premiers jours ne montrent pas d’amélioration spectaculaire.
Les mesures non médicamenteuses doivent toujours être privilégiées en première intention. L’exposition à la lumière, l’activité physique, la stimulation cognitive avec des programmes comme EDITH ou JOE, la structuration de la journée, l’optimisation de l’environnement de sommeil sont plus efficaces et plus sûres que les médicaments.
La formation des aidants, proposée par DYNSEO, est un investissement précieux pour acquérir les compétences nécessaires à la mise en place de ces protocoles. Elle transforme l’impuissance face aux nuits difficiles en action constructive, et l’épuisement en espoir de nuits plus paisibles.
N’oublions pas que le sommeil de l’aidant est tout aussi important que celui de la personne aidée. Préserver son propre repos, accepter de l’aide, partager la charge des nuits difficiles ne sont pas des signes de faiblesse mais des conditions indispensables pour tenir sur la durée et accompagner avec qualité.
Des nuits plus paisibles sont possibles. Elles nécessitent des efforts et de la constance, mais les bénéfices pour tous en valent largement la peine.
Ressources et accompagnement DYNSEO
Pour les professionnels de santé
Formation « Troubles du comportement liés à la maladie : méthodes et coordination pluridisciplinaire »
Modules approfondis sur les protocoles jour/nuit et la gestion de l’agitation nocturne.
👉 Accéder à la formation professionnels
Pour les familles et les proches aidants
Formation « Changements de comportement liés à la maladie : guide pratique pour les proches »
Outils pratiques pour gérer les troubles du sommeil au quotidien.
👉 Accéder à la formation familles
Programmes de stimulation cognitive
EDITH – Pour les seniors
Activités structurantes pour maintenir l’éveil diurne et favoriser le sommeil nocturne.
JOE – Coach cérébral pour adultes
Programme pour maintenir l’engagement cognitif en journée.
—
Mots-clés : troubles du sommeil, insomnie personnes âgées, agitation nocturne, Alzheimer sommeil, rythme circadien, protocole jour nuit, sundowning, gestion réveils nocturnes, formation aidants, épuisement aidants, DYNSEO




